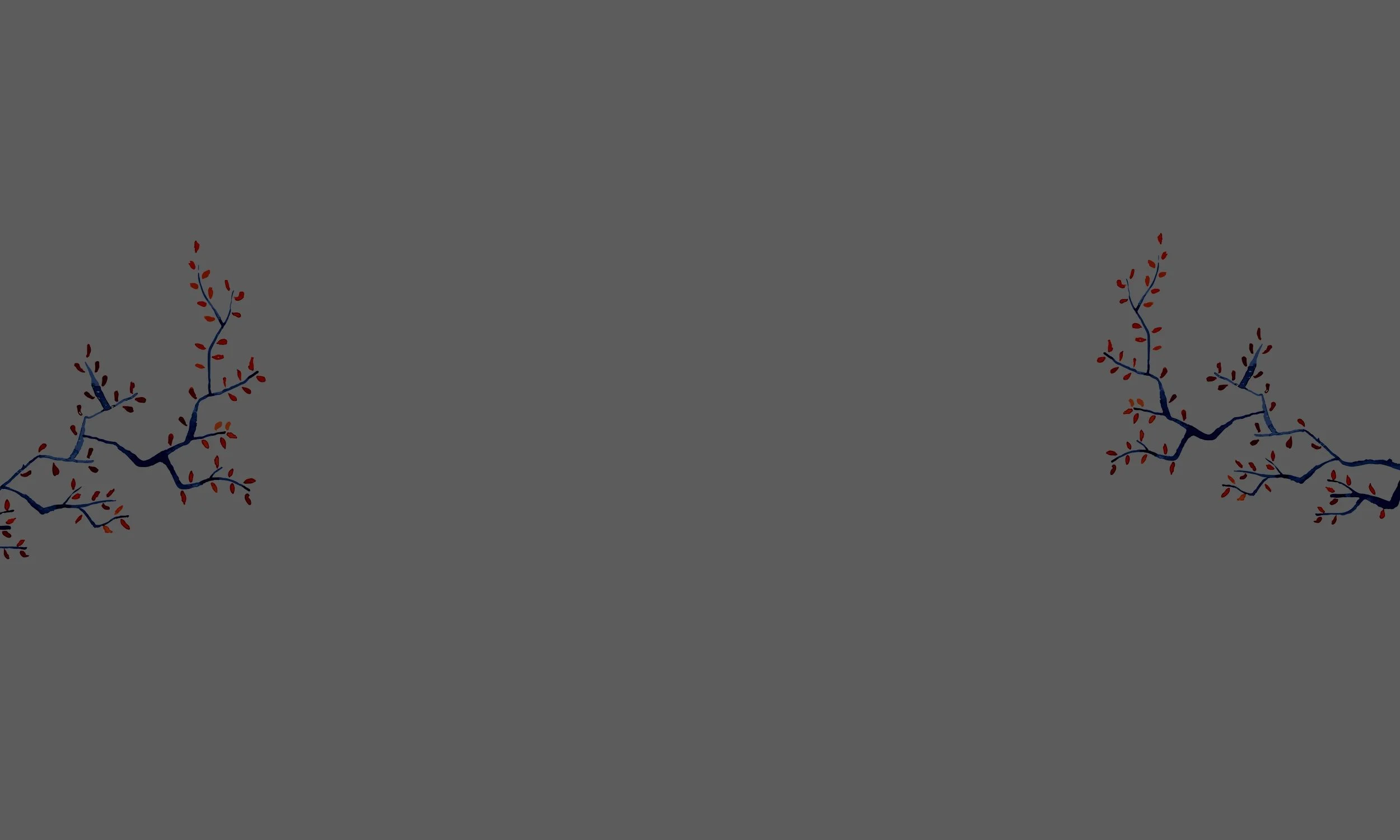Canada
Le CRIN souhaite exprimer sa profonde gratitude aux réviseurs externes Cheryl Milne, Elise Burgert et Hannah West du groupe de travail sur l’environnement du David Asper Centre for Constitutional Rights de l’Université de Toronto, pour leurs commentaires pertinents sur une version préliminaire de ce rapport. Le CRIN a également envoyé une version préliminaire à l’État pour avis et commentaires, et les observations reçues ont été prises en compte dans la finalisation du rapport. Toutes les erreurs ou inexactitudes dans le rapport sont le fait de CRIN.
Ce rapport est fourni à des fins éducatives et informatives uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil juridique. CRIN n'accepte aucune responsabilité pour toute perte, tout dommage, tout coût ou toute dépense encourus ou découlant de l'utilisation ou de la confiance accordée par toute personne aux informations contenues dans ce rapport. CRIN encourage l'utilisation personnelle et éducative de cette publication et accorde l'autorisation de la reproduire à ce titre lorsque le crédit approprié est donné de bonne foi.
Tout le contenu de CRIN est autorisé sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0. Aucun matériel produit par CRIN ne peut être modifié sans un consentement écrit. Aucun matériel produit par CRIN ne peut être réutilisé à des fins commerciales sans un consentement écrit.
I. Les protections juridiques nationales
A. Les droits environnementaux sont-ils protégés par la Constitution nationale ?
Les droits environnementaux ne sont pas ouvertement protégés dans la Constitution canadienne et il n'y a pas non plus de dispositions spécifiques aux enfants.
Les droits individuels sont protégés par la Constitution canadienne en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »).1 La Charte «garantit aux individus les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui y soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique ».2 La Charte s'applique à toutes les personnes,3 et protège par conséquent les droits des enfants comme ceux des adultes.4 Bien que les droits environnementaux ne soient pas expressément inclus, les tribunaux chargés d'interpréter la Charte peuvent établir que certains droits environnementaux sont protégés en tant que droits et libertés mentionnés par la Charte.5 Les articles qui peuvent le plus probablement impliquer un tel droit sont l'article 7 (le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne) et l'article 15 (le droit à la même protection légale et au même bénéfice de la loi). Les droits environnementaux peuvent également être identifiés en vertu de l'article 35 de la Charte, qui affirme les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones du Canada, indépendamment de tous droits et libertés individuels supplémentaires. Ces droits et libertés sont discutés ci-dessous, et plus loin sont adressées les affaires environnementales traitant de ces droits.
Bien que la Charte ne comprenne pas explicitement les droits environnementaux, il est possible d’affirmer qu'un tel droit soit englobé dans le cadre de l'article 7 de la Charte, qui protège les Canadiens contre les atteintes aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale.6 L’article 7 prévoit que « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. »7 Le droit à la liberté protégé par l'article 7 comprend le droit de l'individu à prendre des « décisions importantes et essentielles de la vie » libres d'intrusion par l'État, y compris le choix d’un lieu d’habitation.8
Afin de mener une procédure judiciaire sous couvert de l'article 7, le demandeur doit d'abord démontrer qu’une action gouvernementale a un effet sur sa vie, sa liberté ou la sécurité de sa personne. Il incombe alors au gouvernement de démontrer que la privation était conforme aux principes de justice fondamentale.
L’article 15(1) de la Charte prévoit que « La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. » Le demandeur doit démontrer que (1) la loi traite les personnes différemment dans son objectif ou ses effets, avec un motif déterminé (notamment le sexe, la race, l'origine nationale ou ethnique, le handicap et l'orientation sexuelle) et (2) la différence de traitement entraîne une discrimination, définie comme la perpétuation d'un désavantage historique contre le(s) groupe(s) en question.9
Même si l'article 15 de la Charte fait une référence explicite à « l'âge » comme motif déterminé, en réalité, il reste difficile pour les enfants d'établir une demande fondée sur l'âge en vertu de cet article. Les tribunaux ont souvent statué que la violation et/ou le déni des droits des enfants sur la base de leur âge peuvent être justifiés et démontrés comme étant une limite raisonnable en vertu de l'article 1 de la Charte. Il a été statué que les restrictions imposées aux enfants sont des directives appropriées menées par le gouvernement et méritant la déférence, et que les violations et/ou le déni des droits des enfants répondent aux besoins et capacités réels des enfants et ne peuvent donc pas être qualifiés comme discrimination.10
Il existe d'autres exemples de lois sur les droits de la personne au Canada qui autorisent tacitement la discrimination contre les enfants et les jeunes en raison de leur âge. Par exemple, dans le Code des droits de la personne de l'Ontario, la notion d’âge ne comprend pas les personnes ayant moins de 18 ans.11 L'affaire Arzem c. Ontario (Services sociaux et communautaires)12 a pu remettre en cause cette définition de l'âge dans le Code des droits de la personne de l'Ontario. Néanmoins, le Code définit toujours la notion d’âge à partir de 18 ans.
Dans le contexte des contentieux environnementaux, plusieurs ont été enregistrés en vertu des articles 7 et 15, souvent conjointement.13 Ces contentieux sont discutés dans la partie I.B ci-après.
Toutefois, il convient également de reconnaître que, même si les droits environnementaux étaient inclus dans la Constitution canadienne, ces droits seraient assujettis à des restrictions.
Par exemple, la Charte offre une protection seulement contre les actions du gouvernement, et non contre les actions privées, qui sont réglementées par d'autres lois et règlements. Deuxièmement, le gouvernement peut imposer des « limites légitimes et raisonnables » aux droits et libertés en vertu de l'article 1 de la Charte, ce qui signifie que les droits garantis par la Constitution canadienne ne sont pas illimités. Troisièmement, en vertu de l'article 33 de la Charte, le gouvernement peut choisir d'abroger un droit garanti par la Charte par un décret législatif spécifique, nonobstant le non-respect de la Charte. Dans de nombreux cas, un droit peut également être limité par les faits de l'affaire, car la jurisprudence relative à la Charte est fondée sur les faits. À ce jour, aucune jurisprudence n'a été trouvée dans laquelle la clause « nonobstant » a été utilisée pour limiter le droit de l'environnement. Quatrièmement, les droits environnementaux peuvent également exister en tant que principe constitutionnel tacite, ce qui est un domaine controversé de la jurisprudence constitutionnelle. Les principes tacites sont des « hypothèses tacites » qui « ont dicté les aspects majeurs de l'architecture même de la Constitution elle-même et en sont la force vitale. » Ainsi, des principes tacites guident l'interprétation et le développement de la Constitution et l'évolution de la Charte.14 Bien que les tribunaux n'aient encore reconnu aucun principe constitutionnel non écrit lié à l'environnement, la Cour suprême du Canada a décrit les droits environnementaux en utilisant un langage fort. Dans R. c. Hydro-Québec, la Cour suprême du Canada a estimé que « les mesures juridiques visant à protéger l'environnement se rapportent à un objectif public d'importance primordiale » et dans Ontario c. Canadien Pacifique Ltée. elle établit la « gérance de l'environnement naturel »15 comme une « valeur essentielle », et un environnement sûr et sain comme une « valeur essentielle et largement partagée ».16 En outre, dans sa décision 114957 Canada Ltée (Spray-Tech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), la Cour suprême a déclaré que « notre avenir commun, celui de toutes les communautés canadiennes, dépend d'un environnement sain ». Cette Cour a reconnu que « tout le monde sait qu'individuellement et collectivement, nous sommes responsables de la préservation de l'environnement naturel [...] la protection de l'environnement est devenue une valeur essentielle de la société canadienne ».17
Article 35 de la Charte
L'article 35 de la Charte prévoit que « Les droits existant - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés » et offre ainsi aux peuples autochtones un moyen institutionnel de résister aux violations de leurs droits.
Les droits ancestraux ne sont pas définis par l'article 35. Cependant, la Cour suprême a cherché à définir les droits ancestraux au cours du temps, par le biais d'arrêts historiques tels que R. c. Calder et R. c. Sparrow.
L'affaire de R. c. Sparrow concerne Ronald Sparrow, un membre de la communauté Musqueam, arrêté pour avoir pêché dans le fleuve Fraser avec un filet plus long que ce qui était autorisé par son permis de pêche de subsistance du gouvernement canadien. La communauté Musqueam a considéré l'arrestation de Sparrow comme une menace à leurs droits collectifs. Ils pensaient qu'ils avaient le droit inhérent et imprescriptible de maintenir leur culture et leur mode de vie, en particulier en ce qui concerne la pêche, et que les réglementations portant atteinte à leurs droits étaient injustifiées et invalides. Malgré près d'un siècle de réglementations et de restrictions du gouvernement canadien sur le droit de pêcher des Musqueam, la Cour suprême a statué que leur droit ancestral existant de pêcher n'avait pas été éteint. La Cour a interprété les mots « reconnus et confirmés », tels qu'ils apparaissent à l'article 35, comme signifiant que le gouvernement canadien ne peut pas ignorer ou enfreindre ces droits sans justification.
Malgré la victoire partielle pour la communauté Musqueam et pour les droits ancestraux, dans l'affaire R. c. Sparrow la Cour a précisé que les droits ancestraux ne sont pas absolus et que leur violation par le gouvernement canadien peut être justifiée dans des circonstances particulières (le test Sparrow). La protection accordée par l'article 35 est loin d'être omniprésente et sa véritable efficacité reste incertaine. D’aucuns affirment que l'article 35 renforce simplement la colonisation des communautés autochtones parce qu'il soumet les nations autochtones aux règles et règlements canadiens, reconnaissant en définitive la loi canadienne comme suprême.18
La jurisprudence a interprété les droits ancestraux comme comprenant une série de droits culturels, sociaux, politiques et économiques, y compris le droit à la terre et à revendiquer un titre, ainsi que le droit de pêcher, de chasser et de pratiquer sa propre culture, et d'établir des traités. Les tribunaux ont reconnu que la dégradation de l'environnement et les projets de développement des ressources, ainsi que les projets d'infrastructure, peuvent violer les droits ancestraux protégés par la Constitution en raison de leur impact sur l'environnement.19
Néanmoins, on ignore si ces droits comprennent le droit à un environnement sain et s’il y a eu de nombreux cas dans lesquels les revendications des droits ancestraux n'ont pas tout à fait réussi à protéger les ressources environnementales. Par exemple, dans Mikisew Cree First Nation c. Canada (gouverneur général en conseil),20 la Cour suprême a statué que l'État n'avait pas l'obligation de consulter les groupes autochtones au cours du processus législatif, même si les lois en cours d'adoption pouvaient avoir une incidence négative sur les droits ancestraux ou issus de traités. La Cour suprême a estimé que les groupes autochtones avaient un accès plus adapté aux recours après la promulgation des lois, sans imposer à l'État une obligation de consulter qui, selon eux, porterait atteinte à la souveraineté et au privilège parlementaires.
B. Les droits constitutionnels ont-ils été appliqués par les tribunaux nationaux en ce qui concerne les questions environnementales ?
Article 7 et article 15 de la Charte
Comme indiqué ci-dessus, il y a des procédures en cours en vertu des articles 7 et 15, qui ont été intentées par des enfants qui estiment avoir été victimes de discrimination, en ce qui concerne l'environnement, sur la base de leur âge, une catégorie protégée en vertu de l'article 15. Des procédures similaires ont également été intentées par des plaideurs autochtones.
- En 2011, des membres de la Première Nation Aamjiwnaang ont demandé une révision judiciaire contre la décision du Ministère de l'Énergie de l'Ontario d'autoriser une pollution supplémentaire provenant d'une raffinerie Suncor près de leur communauté à Sarnia, en Ontario, au motif qu'elle violait leurs droits en vertu des articles 7 et 15. Ils ont abandonné les poursuites en 2016 au vu d’indices montrant que le gouvernement de l'Ontario prenait des mesures contre la pollution.21
- En septembre 2015, des membres de la Première Nation Grassy Narrows ont soutenu que la coupe à blanc proposée sur leur territoire traditionnel aggraverait la contamination par le mercure préexistante et menacerait la santé humaine.22
- ENvironnement JEUnesse (ENJEU) a déposé une requête auprès de la Cour supérieure du Québec demandant l'autorisation de lancer un recours collectif contre le gouvernement du Canada au nom de tous les résidents du Québec âgés de 35 ans et moins. L’organisation soutient que le gouvernement du Canada n'a pas pris les mesures suffisantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre face au changement climatique et par conséquent, n'a pas protégé les droits fondamentaux de la jeunesse québécoise en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. La Cour supérieure du Québec a rejeté la demande d'ENJEU d’utiliser un recours collectif au motif qu'elle ne répondait pas aux exigences nécessaires pour procéder à un tel recours. La Cour a conclu que la limite d'âge de 35 ans était arbitraire et inappropriée, puisqu'elle n'a pas considéré que l’argumentaire motivant ce choix était suffisamment justifié.23 La Cour a également estimé qu’ENJEU n'avait pas le pouvoir d'agir au nom des mineurs dans le recours collectif proposé, car les mineurs ne pouvaient pas être membres de recours collectifs. Le juge Morrison a déclaré : « Au Québec, l'âge de la majorité est fixé à 18 ans. Ce n'est qu'à cet âge qu'une personne devient capable d'exercer pleinement tous ses droits civiques... Environnement Jeunesse peut donner une "voix" aux jeunes, mais n'a pas le pouvoir de modifier le statut juridique et les pouvoirs des mineurs. »24 ENJEU a fait appel de la décision de la Cour supérieure devant la Cour d'appel du Québec, affirmant que leur décision de se concentrer sur les jeunes (c'est-à-dire les personnes de moins de 35 ans) n'était pas arbitraire. ENJEU a affirmé que les personnes ayant moins de 35 ans seraient impactées de manière disproportionnée par l'inaction climatique, et qu'elles avaient tout à fait le droit de se concentrer sur les besoins et les intérêts des jeunes. ENJEU a également tenté de contester les décisions du juge Morrisons sur l'inclusion des mineurs dans le recours collectif. La Cour d'appel a rejeté l'appel et n'a pas relevé les allégations soutenant que les actions du gouvernement canadien contribuaient au changement climatique et violaient donc les droits garantis par la Charte.25 ENJEU a déposé une demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême, mais en juillet 2022 la Cour suprême a rejeté la demande.26 Ce raisonnement judiciaire pourrait constituer un frein pour les personnes qui présentent des contentieux climatiques fondés sur l'âge au Canada.
- L'affaire Mathur et al c. Ontario (procureur général) a été déposée devant la Cour supérieure de l'Ontario en novembre 2019. Un groupe de sept jeunes plaignants a demandé plusieurs déclarations : premièrement, une déclaration confirmant que leurs droits ont été violés conformément aux articles 7 et 15 ; deuxièmement, une déclaration établissant que les objectifs de l'Ontario enfreignent un principe constitutionnel non écrit selon lequel le gouvernement ne pourrait pas adopter de conduite pouvant nuire aux citoyens ; troisièmement, une déclaration que les articles de la Loi constitutionnelle qui permettaient des objectifs liés à l’Accord de Paris moins stricts sont inconstitutionnels et inopérants, et enfin, ils demandent une décision obligeant l'Ontario à mettre en œuvre un objectif de réduction des gaz à effet de serre et à réviser son plan climat.27 En avril 2020, le gouvernement de l'Ontario a déposé une requête en irrecevabilité, arguant que la Charte ne garantit pas un droit à un climat stable, que les demandeurs n'ont pas qualité pour représenter les générations futures, que les demandeurs n'ont démontré aucune cause d'action raisonnable et qu'ils ne peuvent pas prouver leurs allégations. En novembre 2020, la Cour a rejeté la requête en irrecevabilité au motif qu'il n'était pas clair et évident que les demandeurs ne présentent aucune cause d'action raisonnable. Le juge a estimé que l'objectif de réduction des GES et l'abrogation de la loi sur les changements climatiques peuvent être revus par le tribunal pour leur conformité à la Charte. Selon les plaignants, c'est la première fois qu'un tribunal canadien statue que les changements climatiques peuvent menacer les droits fondamentaux en vertu de la Charte.28 L'affaire est toujours en instance.
- L’affaire La Rose c. Sa Majesté la Reine a été déposée à la Cour fédérale en 2019. Quinze plaignants âgés de 10 à 19 ans ont porté plainte contre le procureur général du Canada, affirmant que l’inaction du gouvernement canadien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre porte atteinte à leurs droits en vertu des articles 7 et 15.29 En octobre 2020, la Cour a rejeté l'affaire sur la base d'une requête en irrecevabilité présentée avant le procès, au motif qu'elle n'avait pas établi de cause d'action raisonnable. Les demandeurs ont fait appel de l'affaire devant la Cour d'appel fédérale en novembre 2020 et, en mai 2021, ils ont présenté leur exposé des faits et du droit.30 L'affaire est toujours en instance.
- Dans le cas de Lho'imggin et al. c. Sa Majesté la Reine,31 deux factions du groupe autochtone Wet’suwet’en ont déposé un recours en justice en février 2020, soutenant que l’attitude du gouvernement canadien en matière de changement climatique violait leurs droits constitutionnels et leurs droits humains. L’État du Canada (le défendeur) a déposé une requête en irrecevabilité qui a été accordée par la Cour fédérale, sans permission d'amendement au motif que l'affaire n'était pas justiciable, n'avait aucune cause d'action raisonnable et que les recours n'étaient pas légalement disponibles. La Cour a écrit : « la question du changement climatique, bien qu'extrêmement importante, est intrinsèquement politique, non juridique, et relève des pouvoirs exécutif et législatif du gouvernement.»32 En outre, la Cour a conclu que puisque les demandeurs n'avaient pas fait référence à des articles spécifiques des lois qui entraînaient des violations spécifiques des droits garantis par la Charte, leurs réclamations ne présentaient aucune cause d'action raisonnable. En ce qui concerne les recours, la Cour a estimé que le problème complexe du changement climatique rendait le contrôle judiciaire insignifiant et que, par conséquent, la Cour ne pouvait pas assumer un rôle de surveillance pour garantir que des lois adéquates étaient adoptées. Le demandeur a fait appel auprès de la Cour d'appel fédérale et a fourni un exposé des faits et du droit. L'affaire est en instance.33
Les tribunaux au Canada jouent un rôle important dans l'application des lois. Ils exercent des pouvoirs d'appel et de révision sur les décisions administratives en matière d'environnement. Dans certaines provinces, la législation sur la protection de l'environnement exige expressément aux tribunaux de déterminer la responsabilité et de répartir les dommages pour les atteintes à l'environnement, bien que la plupart des litiges en protection de l'environnement soient réglés, en première instance, par des tribunaux administratifs spécialisés en législation environnementale. Par exemple, le Tribunal de l'environnement de l'Ontario tranche les demandes et les appels en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario (« LPE de l'Ontario ») et la Commission d'appel de l'environnement de la Colombie-Britannique entend les appels des décisions des fonctionnaires en vertu de la Loi sur la gestion de l'environnement (une loi similaire à la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario).34
Un particulier peut-il intenter une action en justice contre un pollueur, un propriétaire ou un occupant ?
Dans tous les territoires canadiens, un particulier peut intenter une action en justice contre un pollueur, un propriétaire ou un occupant pour des dommages liés à la pollution. La plupart des actions sont fondées sur la nuisance, l'intrusion, la négligence et la responsabilité sans faute. Dans certaines provinces, comme l'Ontario, un demandeur peut également demander réparation selon une cause d'action prévue par la loi. Cette question est examinée plus en détail dans la partie II.
C. Le concept d’équité intergénérationnelle a-t-il été appliqué au sein des juridictions nationales ? Si tel est le cas, dans quelles circonstances ?
L'équité intergénérationnelle n'a pas été appliquée par les juridictions nationales en tant que principe fondamental. Cependant, l'équité intergénérationnelle est considérée dans des affaires concernant les terres possédées en vertu d'un titre autochtone, à la fois dans les incursions gouvernementales dans ces terres et dans l'utilisation appropriée par les peuples autochtones. Dans l’affaire Nation Tsilhqot'in c. Colombie-Britannique, la Cour suprême du Canada a statué que « le gouvernement doit agir d’une manière qui respecte le fait que le titre ancestral est un droit collectif inhérent aux générations actuelles et futures » et en outre que les terres faisant l'objet d'un titre aborigène ne peuvent pas être utilisées à des fins qui détruiraient « la capacité de ces terres d’assurer la subsistance des générations futures des peuples autochtones ».35 Ce concept n'a pas été développé davantage par la jurisprudence par la suite.
D. Quelle législation est en place pour réglementer la protection de l’environnement ? Existe-t-il des propositions de réformes juridiques actuellement en cours d’examen au sein de la législature nationale ?
Il existe une quantité importante de lois au Canada qui réglementent les impacts sur l'environnement. Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ou territoriaux ont tous deux compétence dans les domaines de la protection de l'environnement, selon la séparation des pouvoirs voulue par la Constitution canadienne. Par conséquent, le gouvernement fédéral et les provinces/territoires ont tous promulgué des lois et des règlements. À ce titre, il y a souvent un chevauchement, sinon une contestation des revendications d'autorité législative, entre les organismes de réglementation fédéraux et provinciaux ou territoriaux.36 La Cour suprême du Canada a confirmé de façon constante les pouvoirs des gouvernements fédéraux,37 provinciaux38 et municipaux39 pour réglementer la protection de l'environnement.40 Les moyens de régler ces conflits sont examinés dans la partie II.
Les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral réglementent les processus d'évaluation des impacts environnementaux et les régimes de permis qui autorisent le rejet de polluants dans l'air, l'eau et le sol (en bref, les projets doivent avoir un permis pour rejeter des polluants et ils enfreignent leurs permis si les rejets réalisés dépassent les limites fixées dans le permis). Il existe des lois supplémentaires pour protéger la faune et la flore. De plus, le gouvernement fédéral et toutes les provinces appliquent des régimes de conformité autorisant la délivrance de divers types d'ordonnances et la poursuite des délinquants qui ont perpétré des crimes environnementaux. La plupart des organismes de réglementation environnementale au Canada ont nommé des agents d'enquête et d'application de la loi, dotés de pouvoirs similaires à ceux accordés aux agents de police. Par exemple, les agents se voient généralement accorder de larges pouvoirs d'entrée, ainsi que des pouvoirs spécifiques pour effectuer des tests environnementaux, examiner et prendre des documents et faire des enquêtes raisonnables. Les agents chargés de l'application de la loi ont généralement la possibilité de demander une autorisation judiciaire pour exercer leurs pouvoirs dans des circonstances où le consentement ne peut être obtenu.41 De plus, le gouvernement fédéral a imposé une taxe sur le carbone, qui prévoit que les provinces doivent promulguer leurs propres lois pour satisfaire aux critères fédéraux ; dans le cas contraire, la loi fédérale s'appliquera comme filet de sécurité.
Le niveau d'application de la réglementation environnementale varie selon le territoire, la volonté politique, les ressources disponibles et la demande du public, et certaines tensions existent entre la législation environnementale fédérale et provinciale (voir ci-dessous).
L'Ontario est le plus actif en termes d'application de la loi.42
Lois fédérales
Les principales lois fédérales relatives à la protection de l'environnement sont les suivantes :
- Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
- Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
- Loi sur les espèces en péril, 2002
- Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
- Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (1997)
Les autres législations environnementales spécialisées comprennent :
- Loi sur les pêches (1985)
- Loi sur l'évaluation d'impact (2019)
- La Loi sur les eaux navigables canadiennes (1985)
- Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (1985)
- Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
- Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
De plus, le gouvernement fédéral a signé de nombreux accords internationaux relatifs à la protection de l'environnement, notamment :
- L’Accord de Copenhague : le Canada s’est engagé à réduire de 17 % ses émissions par rapport aux niveaux de 2005, d’ici 2020.
- L'Accord de Paris43 (dérivé de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) : le Canada a ratifié l'accord en 2015, s'engageant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030.
- L'accord de Kigali, un amendement au Protocole de Montréal : un ensemble de mesures réglementaires visant à réduire progressivement les hydrofluorocarbures (HFC).
- La Coalition pour le climat et l'air pur pour réduire les polluants climatiques de courte durée : une initiative volontaire visant à protéger l'environnement et la santé publique et à lutter contre le changement climatique.44
- De nombreux accords environnementaux bilatéraux et multilatéraux avec des nations du monde entier.45
La législation provinciale reflète en grande partie la législation fédérale en ce qu’elle réglemente le rejet de polluants au moyen de régimes de permis, les prélèvements de la faune et de la flore et en prévoyant des procédures d'approbation pour les projets d'infrastructure provinciaux. Les principales lois provinciales et territoriales sont présentées ci-dessous :
| Province | Loi |
| La Colombie-Britannique | Loi sur la gestion de l’environnement, SBC 2003, c 53 |
| L’Alberta | Loi sur la protection et l’amélioration de l’environnement, RSA 2000, c E-12 |
| La Saskatchewan | Loi sur la gestion et la protection de l’environnement, 2010c. E-10.22 |
| Le Manitoba | Loi sur l’environnement c. E125 de la C.P.L.M. |
| L’Ontario | Loi sur la protection de l’environnement, LRO1990, c. E. 19 |
| Le Québec | Loi sur la qualité de l’environnement c. Q-2 |
| Le Nouveau-Brunswick | Loi sur la qualité de l’air, LN-B 1997, c C-5.2 et la Loi sur la qualité de l’environnement, LRN-B 1973, c C-6 |
| Les Territoires du Nord-Ouest | Loi sur les droits environnementaux46 |
| La Nouvelle-Écosse | Loi sur l’environnement, SNS 1994-95, c 1 |
| Le Nunavut | Loi sur la Protection de l’environnement47 |
| L’Île-du-Prince-Édouard | Loi sur la protection de l’environnement, RSPEI 1988, c E-9 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Loi sur la protection de l’environnement, SNL 2002, c E-14.2 |
| Le Yukon | Loi sur l’environnement LRY 2002, c.7648 |
Réforme législative
Au niveau fédéral, un projet de loi émanant d'un député visant à promulguer une « Charte canadienne des droits environnementaux » a été présenté en 2019.49 Le projet de loi n'a jamais été promulgué, car il n'a pas passé la deuxième lecture à la Chambre des communes.50 Le gouvernement fédéral travaille également à l’implémentation du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Il est engagé aussi dans d'importantes initiatives de réforme dans les domaines de l'évaluation environnementale, des pêches et des eaux navigables.
La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité (projet de loi C-12) exige la création d’objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada (établies par le ministre de l'Environnement) pour 2030, 2035, 2040 et 2045, avec l'objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Cependant, le Projet de loi C-12 n'inclut pas actuellement un mécanisme d’application qui lie légalement le gouvernement fédéral pour obliger le Canada à rendre des comptes. On s'attend également à ce que certaines provinces tentent de contester le pouvoir constitutionnel qu’a le Canada pour adopter de telles lois parce que la plupart des provinces croient qu'un régime fédéral de réglementation des changements climatiques est paternaliste et usurpe le droit des provinces d'imposer leurs propres politiques (voir la discussion sur la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES) dans la partie III).
En 2022, le gouvernement du Canada s'est engagé à modifier et à renforcer (par le projet de loi S-5) la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE), et a reconnu le droit des Canadiens à un environnement sain et le devoir du gouvernement de protéger ce droit lors de l'application de la LCPE.51 Cela comprend l'élaboration d'un cadre de mise en oeuvre, détaillant notamment « comment des principes tels que la justice environnementale et la non-régression seraient considérés dans l'exécution de la LCPE, ainsi que la façon dont le droit serait soupesé avec des facteurs pertinents, notamment les facteurs sociaux, économiques, scientifiques et relatifs à la santé ».52 Selon le gouvernement, les modifications mettront l'accent sur la protection des populations vulnérables, l'évaluation des expositions réelles, le renforcement du régime applicable aux substances toxiques en vertu de la LCPE et présentant les risques les plus élevés, le soutien à la transition vers des produits chimiques plus sûrs, l'augmentation de la transparence dans la prise de décisions, la réduction de la dépendance aux tests sur les animaux et l'introduction de modifications à la Loi sur les aliments et drogues pour renforcer l'évaluation des risques environnementaux et la gestion des risques des médicaments, entre autres.53 Le cadre « sera élaboré par des consultations approfondies » et « les ministres rendront compte de l'exécution du cadre chaque année ».54
La plupart des provinces poursuivent activement diverses initiatives de réforme du droit de l'environnement :
- En 2022, le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick (RENB) a proposé une loi intitulée Charte des droits environnementaux du Nouveau-Brunswick : Une loi pour protéger les enfants, tous les Néo-Brunswickois et la nature, qui inclut les enfants dans son titre afin de souligner la vulnérabilité particulière des enfants à la pollution de l'environnement, dans le but de protéger la santé humaine en reconnaissant que les enfants, et donc toutes les personnes et les générations futures, ont droit à un environnement sain.55
- Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a adopté une Déclaration sur les valeurs environnementales en 2022 pour s'assurer que les impacts des changements climatiques sont spécifiquement pris en compte lors de la prise de décisions gouvernementales.56
- En Colombie-Britannique, les modifications à la Loi sur la gestion de l'environnement, qui ont modifié le processus d'identification des sites contaminés, sont entrées en vigueur en 2021.57 Après que le rapporteur spécial des Nations Unies sur les substances toxiques et les droits de l’homme ait signalé que les peuples autochtones du Canada sont touchés de manière disproportionnée par les déchets toxiques, la Colombie-Britannique a transposé la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en une loi en 2019.58 Depuis l'adoption de cette loi, la Colombie-Britannique a été impliquée dans de nombreux conflits très médiatisés sur les ressources, tels que Coastal GasLink Pipeline Ltd. c. Huson.59 En décembre 2021, la Colombie-Britannique a publié sa stratégie sur l'hydrogène pour accélérer le développement du secteur, aider à réduire les émissions et surmonter la dépendance aux combustibles fossiles.60
- Le Québec a modifié la Loi sur la qualité de l'environnement en 2020 pour moderniser le régime des autorisations environnementales et modifier d'autres dispositions législatives, notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (projet de loi 102).61
- La Charte des droits environnementaux de l'Ontario a été modifiée et considérablement affaiblie, notamment en supprimant le poste et le bureau du commissaire à l'environnement de l'Ontario en 2019.62 Des modifications au Règlement sur les combustibles de remplacement à faible teneur en carbone (règlement de l'Ontario 79/15), visant à rationaliser le processus d'approbation permettant à certains fabricants de passer des combustibles fossiles aux matériaux de carburant alternatifs, ont été annoncées en 2021.63 L'Ontario a « un contrôle réglementaire limité sur les émissions d'odeurs au-delà des larges interdictions législatives contre les émissions qui peuvent causer un effet négatif » et, bien qu'une mise à jour du guide pour traiter les mélanges d'odeurs ait été annoncée en 2021, l'incertitude dans ce domaine reste un obstacle « même pour commencer des propositions de développement ».64 Le gouvernement de l'Ontario a également exécuté des réformes législatives qui modifient fondamentalement le régime de gérance des produits.65
Cependant, il existe des tensions entre les lois environnementales fédérales et celles provinciales et les récentes réformes des lois environnementales de nombreuses provinces entrent en conflit avec les règlements existants et les affaiblissent. Dans ce contexte, la Saskatchewan, l'Ontario et l'Alberta ont contesté la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES) et le contentieux a été porté devant la Cour suprême du Canada (CSC) au motif que la loi était inconstitutionnelle (Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre).66 Bien que cette décision permette au système fédéral de tarification du carbone de continuer à s'appliquer dans les provinces et les territoires qui n'ont pas de système de tarification du carbone adapté, le pouvoir qu’a le Parlement de réglementer plus largement les réductions d'émissions provinciales reste mal défini.67 De même, la réglementation des substances toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement a aussi été contestée devant la CSC (R c Hydro-Québec, [1997] 3 RCS 213) et a par la suite été considérée comme une loi fédérale valide par la Cour.68 Plus largement, un autre exemple de ces tensions est la récente Loi sur la souveraineté de l'Alberta, encadrée par la « Free Alberta Strategy », qui vise à donner au gouvernement provincial le pouvoir de refuser d'appliquer une loi fédérale censée porter atteinte aux droits provinciaux de l'Alberta ou attaquer les intérêts des citoyens de la région.69 Au Canada, la Loi constitutionnelle de 1867 (articles 91 et 92) donne le pouvoir législatif au Parlement du Canada et aux provinces sur leurs domaines respectifs.70 Cependant, ce pouvoir est donné de façon plutôt générique et cela n'inclut pas toutes les questions législatives possibles, comme l'environnement, ce qui peut amener les deux niveaux de gouvernement à adopter des lois qui se chevauchent.71 Bien que les principes du fédéralisme coopératif et de la doctrine du double aspect (récemment appliqués, par exemple, à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre 2021 CSC 11) permettent ce chevauchement, la doctrine de la prépondérance fédérale, qui a été confirmée par la CSC, accorde la priorité au gouvernement fédéral sur la compétence provinciale dans les situations où la loi provinciale entre clairement en contradiction avec un pouvoir fédéral.72 Quant à la doctrine de l'exclusivité des compétences, qui, selon la CSC, ne devrait pas être appliquée sur tous les plans, elle reconnaît que « les domaines sont censés relever principalement de la compétence d'un niveau de gouvernement plutôt que simultanément. »73 La CSC a conclu que « l'environnement n'est pas, en tant que tel, un domaine législatif en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 » ... « il s'agit plutôt d'un sujet diffus qui touche plusieurs domaines différents de responsabilité constitutionnelle, dont certains sont fédéraux, et d'autres provinciaux. »74
E. Existe-t-il une politique nationale spécifique traitant de l'exposition des enfants aux substances toxiques ? Si tel est le cas, comment est défini un niveau d'exposition et de quelle manière sont déterminés les niveaux d'exposition sans danger ?
D'après nos recherches, il n'existe pas de politique nationale spécifique traitant de l'exposition des enfants aux substances toxiques. Cependant, l'Association canadienne du droit de l'environnement a recommandé que « [l]e gouvernement fédéral doit être directement impliqué dans la recherche sur la surveillance (y compris l'exposition et le charge corporelle) des substances chimiques et l'étude longitudinale de la santé des enfants. Ce travail devrait être coordonné avec les efforts internationaux déjà en cours de développement. »75 Les substances toxiques sont inscrites à l'annexe 1 de la LCPE, et Environnement Canada et Santé Canada sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de règlements ou d'autres instruments qui permettront de prévenir ou de contrôler leur utilisation et/ou leur rejet.76
F. Le pays est-il équipé de registres des rejets et transferts de polluants ? Si tel est le cas, ces registres prennent-ils en compte des facteurs spécifiques aux enfants concernant les substances pour lesquelles des données ont été collectées et le type de données a été généré ?
Le gouvernement fédéral garde la trace des rejets de polluants grâce à l'Inventaire national des rejets de polluants (« INRP »).77 Les entreprises soumises aux exigences de déclaration en vertu de la LCPE doivent déclarer chaque année à l’INRP, et toutes les données sont disponibles en ligne. Les non-déclarants sont passibles de sanctions. D’après nos recherches, les facteurs spécifiques aux enfants ne sont pas pris en compte.
G. L’État exerce-t-il une compétence extraterritoriale pour toute question environnementale ?
Il existe une présomption générale contre l'extraterritorialité, et les juridictions canadiennes n'appliquent pas les lois canadiennes aux actions qui se produisent à l'extérieur du Canada, à moins que la loi canadienne n'énonce expressément qu'une telle loi s'applique à une situation extraterritoriale. Le problème est en partie dû au fait que les tribunaux n'entendent généralement que les affaires sur lesquelles ils ont compétence, ce qui est établi dans les Règles de procédure civile de chaque province. Le Canada reconnaît généralement les jugements étrangers en vertu des principes de courtoisie internationale, mais les poursuites intentées au Canada pour des actions commises à l'étranger sont généralement rejetées sur le principe de forum non conveniens.78
II. Accès aux tribunaux
A. Comment les affaires environnementales peuvent-elles être portées devant les tribunaux nationaux ?
Les affaires relatives à des atteintes à l'environnement peuvent être portées devant les tribunaux en vertu :
- d'une loi (fédérale ou provinciale) ;
- d'une cause d'action reconnue par la common law ; ou
- de la Constitution.
En bref, la plupart des lois environnementales au Canada sont procédurales plutôt que matérielles.79 Les lois procédurales sont celles qui établissent un processus de prise de décision et peuvent permettre à un individu ou à un groupe touché de participer à un processus de prise de décision environnementale. Ces lois comprennent, par exemple, les processus d'évaluation environnementale ou d'évaluation des incidences, parmi lesquelles la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Les lois substantielles sont celles qui fixent des normes pour le rejet de polluants dans l'air, l'eau ou l'environnement, ou fixent les conditions dans lesquelles une entreprise peut nuire à l'environnement ou une espèce. Ces lois comprennent des lois qui protègent les espèces en voie de disparition et les pêcheries, ainsi qu’une législation générale sur les polluants. Certaines de ces lois – fédérales et provinciales – sont résumées ci-dessous. Cependant, la plupart de ces lois ne confèrent aucun droit environnemental aux individus ou aux groupes. Par conséquent, les personnes préoccupées par la protection de l'environnement ont un accès limité aux tribunaux. Dans certains cas, des individus peuvent intenter des poursuites pour faire appliquer les lois environnementales ou contester la législation ou les décisions des décideurs qui sont ultra vires [NDR: c'est-à-dire débordant le champ de compétence législative]. Dans d'autres cas, un individu ou un groupe peut intenter une action parce qu'on lui a refusé le droit de participer à un processus décisionnel environnemental (voir la discussion sur la qualité pour agir dans la partie II.B ci-dessous). Cependant, dans de tels cas, il résulte du litige la simple affirmation du droit d'être entendu dans un processus de prise de décision, ou la réévaluation d'une question particulière, plutôt qu'une détermination matérielle qu'un droit environnemental a été violé. En réalité et en raison de ce qui précède, dans la plupart des cas, il incombe au gouvernement fédéral ou provincial d'appliquer les lois environnementales le cas échéant, en vertu du pouvoir d'exécution conféré par la loi. Dans certains cas, une entreprise peut encourir des peines au niveau fédéral en vertu du Code criminel du Canada pour certains dommages environnementaux.
Pour les individus qui cherchent à prouver que leurs droits environnementaux, ou leur environnement, ont été affectés négativement, ils peuvent intenter un recours en utilisant le droit commun de la responsabilité délictuelle, ou en faisant valoir que, en lui-même, le préjudice subi constitue une violation d’un droit protégé par la Constitution. Les actions en responsabilité délictuelle sont principalement possibles contre les citoyens privés (bien que, dans certains cas, elles puissent s'étendre aux acteurs gouvernementaux), et les causes d'action constitutionnelles ne sont possibles que contre le gouvernement.
Ce qui suit est un bref résumé de certaines des lois applicables dans chaque cas.
Le droit législatif
La principale voie par laquelle les affaires environnementales sont portées devant les tribunaux est la voie de la législation environnementale, tant fédérale que provinciale.
La plupart des lois environnementales au Canada sont axées sur la prévention de la pollution et établissent un régime de permis pour le rejet de polluants dans l'air et l'eau. Très peu accordent à un individu le droit d'intenter une action ou de réclamer des dommages-intérêts (l'exception notable étant la LCPE, discutée ci-dessous).
Les principales lois fédérales sont :
| Loi fédérale | Résumé |
| Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999, LC 1999, ch. 33 (« LCPE ») | La LCPE est sans doute la législation environnementale la plus puissante du Canada, car elle comprend une liste complète de pouvoirs d'enquête et d'application, y compris le pouvoir d'imposer des ordonnances administratives.
La LCPE affirme que : « la protection de l’environnement est essentielle au bien-être de la population du Canada » et que « l’objet principal de la présente loi est de contribuer au développement durable au moyen de la prévention de la pollution. » La LCPE habilite le ministre responsable pour cette loi à promulguer des plans de prévention de la pollution et à contrôler les substances toxiques, y compris leur importation/exportation et leur rejet en mer, au moyen d'un système de délivrance de permis. La LCPE réglemente également les émissions et les normes des véhicules, et la pollution atmosphérique internationale. Les infractions et les peines sont énoncées à l'article 271.1 et s’échelonnent d'amendes de 15 000 $CAN à 3 000 000 $CAN jusqu’à trois ans de prison. Les particuliers peuvent demander qu'une enquête soit menée par le ministre, et si le ministre omet de mener une enquête dans un délai raisonnable ou répond à l'enquête d'une manière inadaptée, le demandeur peut intenter une action en protection de l'environnement contre une personne qui commet une infraction telle que décrite dans la LCPE qui cause des dommages importants à l'environnement (article 22(1)-(3) et article 23). L'action en protection de l'environnement a une prescription de deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du comportement incriminé (article 23). Dans une action en protection de l'environnement, la charge de prouver l'existence de l'infraction et l'atteinte à l'environnement qui en découle repose sur la prépondérance des probabilités (article 29). Les personnes peuvent également demander une injonction si elles subissent, ou sont sur le point de subir, un préjudice ou une perte à la suite d'un comportement allant à l'encontre de la LCPE, et peuvent poursuivre une personne en dommages-intérêts pour les pertes ou les préjudices subis (articles 39 et 40). |
| Loi sur le contrôle d'application des lois environnementales80 | La loi sur le contrôle d'application des lois environnementales a renforcé et harmonisé les régimes d'application de 9 lois, grâce à un renforcement des amendes. Ces lois sont :
|
| Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28 (LPA) | La LPA réglemente l'utilisation et le transport des produits antiparasitaires, qui doivent être enregistrés en vertu de la LPA.
En vertu de la LPA est coupable d'avoir commis une infraction quiconque contrevient à la loi s’il provoque ainsi :
Une personne qui commet une infraction est passible d'une amende de 200 000 $CAD à 500 000 $CAD et d'une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans. |
| Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LC 2001, ch. 26) | La Loi sur la marine marchande du Canada réglemente les activités de navigation dans les eaux canadiennes, y compris les responsabilités de prévention et d'intervention en matière de pollution relevant du ministère des Transports et du ministère des Pêches et des Océans. |
| Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, L.R.C., 1985, ch. A-12 (LPPEA) | La LPPEA réglemente le rejet de polluants dans les eaux arctiques, sous réserve d’incompatibilité avec la Loi sur la responsabilité en matière maritime (qui réglemente la pollution et les actions en responsabilité délictuelle en mer).
Selon la LPPEA, quiconque (a) s'occupe de prospection, de mise en valeur ou d'exploitation d'une ressource naturelle sur une terre contiguë aux eaux arctiques ou dans une zone sous-marine des eaux arctiques, (b) entreprend une opération sur le continent ou les îles de l'Arctique canadien ou dans les eaux arctiques, ou c) est propriétaire d'un navire qui navigue dans l'Arctique ou propriétaire des cargaisons sur un tel navire, est respectivement responsable des frais, dépenses, pertes ou dommages réels encourus par d’autres personnes résultant de tout dépôt de déchets de tout type dans les eaux arctiques, ou à tout endroit sur le continent ou sur les îles de l'Arctique canadien, si ces déchets ou tout autres déchets résultant du dépôt des déchets peuvent s’introduire dans les eaux arctiques. Dans le cas du propriétaire d’un navire et des propriétaires de sa cargaison, cette responsabilité est solidaire. |
| Loi sur les pêches, L.R.C.1985, c.F-14. | La Loi sur les pêches protège les animaux aquatiques et leur habitat dans les océans et les voies navigables intérieures.
En vertu de l'article 62 du Règlement sur les pêches (dispositions générales), DORS/93-53, une accusation privée portée par un particulier entraînant une condamnation peut conduire au paiement des 50 % de toute amende imposée à la personne qui porte l'accusation ; cependant, « cela a souvent eu une importance limitée car le gouvernement prend en charge les poursuites et, dans la plupart des cas, règle l'affaire sans amende. »81 |
| Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34) | La Loi sur le transport des marchandises dangereuses met l'accent sur la prévention des incidents lorsque des marchandises dangereuses sont importées, manutentionnées, présentées au transport et transportées. La Loi élargit la capacité d'intervention du gouvernement du Canada en cas d'incident de sécurité impliquant des marchandises dangereuses. |
Des dispositions du Code criminel canadien sont également disponibles pour appliquer les lois environnementales, mais ne sont généralement pas utilisées en ce qui concerne les questions environnementales, probablement parce qu'une telle disposition oblige la Couronne à démontrer un élément moral indiquant une imprudence ou une intention (contrairement à la plupart des lois provinciales et fédérales qui imposent une responsabilité objective).
Les provinces ont également des lois environnementales, tout comme les trois territoires canadiens, qui sont décrits ci-dessus dans la partie I. En général, les lois provinciales habilitent le ministre responsable au niveau provincial à faire appliquer les lois par le biais d’amendes et, dans certains cas, par un emprisonnement, ou encore, dans le cadre de la créativité dans le choix des sentences.82 Dans de rares cas, les lois provinciales accordent aux particuliers le droit de faire appliquer la législation environnementale.
Par exemple, la Charte des droits environnementaux de l'Ontario de 1993, crée un registre environnemental et exige qu'un avis de « propositions » y soit publié. Les propositions comprennent des modifications aux règlements et des demandes de certificats d'approbation ou des modifications de certificats d'approbation. La Charte des droits environnementaux de l'Ontario permet au public de commenter les propositions et crée un droit délimité de contester les propositions. L’article 84(1) ch. 28 prévoit que « Lorsqu'une personne a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à une loi, à un règlement ou à un acte […] et que cette contravention effective ou imminente a porté ou est sur le point de porter considérablement atteinte à une ressource publique de l'Ontario, toute personne qui réside en Ontario peut intenter contre cette personne un action relative à l'atteinte devant le tribunal et a droit à un jugement si elle obtient gain de cause », si l'acte porte atteinte à une ressource publique ou cause une nuisance publique.
De plus, le Québec a inscrit le droit à un environnement sain dans sa Loi sur la qualité de l'environnement en 1978 :
En Colombie-Britannique, l'article 47 de la Loi sur la gestion de l'environnement de 2003 crée le droit de percevoir des dommages-intérêts auprès d'une personne responsable de la dépollution dans certaines circonstances.« 19.1. Toute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection, et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des article de la présente loi ainsi que, en matière d'odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
19.2. Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'exercice d'un droit conféré par l'article 19.1.
19.3. La demande d'injonction visée dans l'article 19.2 peut être faite par toute personne physique domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à l'égard duquel une contravention est alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu. Elle peut être faite également par le procureur général et par toute municipalité sur le territoire de laquelle se produit ou est sur le point de se produire la contravention. »
Au Yukon, la Loi sur l'environnement du Yukon prévoit que tout résident qui a « des motifs raisonnables de croire qu'une personne a dégradé ou est susceptible de dégrader l'environnement … peut intenter une procédure auprès de la Cour suprême. »83 De même, tout résident qui a « des motifs raisonnables de croire que … le gouvernement de Yukon a failli à ses responsabilités au titre de dépositaire de l'intérêt public pour protéger l'environnement naturel contre une dégradation réelle ou probable » peut également intenter une procédure.84 Lorsqu'il est démontré que « le rejet d'un polluant a dégradé » l'environnement et que le défendeur a rejeté un polluant de ce type (au moment en cause), il incombe au défendeur de prouver qu'il n'a pas causé de détérioration.85
Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un particulier peut intenter une poursuite contre les personnes responsables des rejets.86
En Ontario, le Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire a été créé en 2021 pour entendre des affaires auparavant entendues par cinq tribunaux distincts, y compris le Tribunal de l'environnement.87 Bien que cette fusion puisse éliminer le recours à des audiences multiples lorsqu'une entreprise nécessite plusieurs approbations, cela soulève la possibilité d'une perte d'expertise du tribunal et, par conséquent, la possibilité d'une réduction de la déférence judiciaire pour le tribunal par les juridictions procédant au contrôle judiciaire d'une décision judiciaire.88
Les efforts des citoyens pour faire respecter les lois environnementales sont souvent entravés. Parmi les victoires, on peut compter l'action du Sierra Legal Defense Fund contre la ville de Kingston en Ontario en vertu de la Loi sur les pêches, qui s'est soldée par une amende de 120 000 $CAN. Une poursuite contre la ville de Hamilton en Ontario a entraîné des amendes de 450 000 $ en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et de la Loi sur les pêches.89 Cependant, dans la plupart des cas, les procureurs généraux prennent le relais des initiatives privées (et, dans de nombreux cas, ils abandonnent toutes les charges).90 Les dispositions sur les poursuites des citoyens qui existent – en Ontario, au Québec, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans la LCPE – sont rarement utilisées.91
Droit coutumier
Alternativement, en common law, un propriétaire foncier peut intenter une action pour délit de nuisance, ou alternativement pour négligence. Les actions en responsabilité délictuelle posent trois problèmes. Le premier est la question de la réparation adaptée. Dans la plupart des affaires délictuelles, le juge accorde une compensation financière plutôt qu'une solution qui empêche la pollution de l'environnement.
Le deuxième problème est qu'au Canada, de nombreuses affaires en responsabilité délictuelle ne sont possibles que si elles sont intentées en tant que recours collectif. Les recours collectifs sont difficiles à maintenir en raison des faibles dommages-intérêts accordés et de la stricte exigence selon laquelle les demandeurs dans un recours collectif subissent un préjudice similaire.92 Cependant, dans Smith c. Inco, un recours collectif a été intenté au nom de 7 000 propriétaires fonciers qui ont allégué que la valeur de leurs propriétés avait diminué en raison de nickel déposé sur ces propriétés par la raffinerie de nickel d'Inco Ltd. à Port Colborne, en Ontario pendant plusieurs décennies, entre 1918 et 1984.93 Le juge a conclu qu'Inco était strictement responsable – selon la jurisprudence de Rylands c. Fletcher – étant donné que « Inco a introduit du nickel sur le terrain dans le but de le raffiner. De plus, une fois le nickel introduit sur le terrain, Inco l'a traité ou raffiné, créant ainsi des particules de nickel en suspension dans l'air. Le nickel n'était pas présent naturellement sur le terrain, et les particules de nickel, elles aussi, n'étaient pas naturellement présentes sur le terrain ou dans l'air au-dessus du terrain. De plus, le raffinage du nickel ne constituait pas une utilisation ordinaire du terrain ; c'était une utilisation spéciale apportant avec elle un danger accru pour les autres. »94
Le troisième problème est la question du défendeur. La plupart des affaires peuvent être établies contre un individu, tel qu'un voisin. Cependant, il est beaucoup plus difficile d'intenter une action en responsabilité délictuelle contre un acteur gouvernemental, et dans de nombreux cas, c'est l'action ou l'inaction du gouvernement qui est au cœur du problème de l'environnement. Par exemple, dans Ernst c. Alberta,95 Ernst a poursuivi l'Energy Resources Conservation Board (l'ancienne ERCB, à présent devenue AER) pour négligence relativement à la contamination de ses eaux souterraines causée par la fracturation hydraulique d'EnCana dans la région. Afin d'établir une réclamation pour négligence, Ernst devait prouver : (1) que le défendeur avait envers le demandeur une obligation de diligence ; (2) que le défendeur avait enfreint la norme de diligence applicable ; (3) que le demandeur avait subi des dommages ; (4) que ces dommages résultaient d'un manquement de la part du défendeur (causalité) ; et (5) que les dommages qui en ont résultés n’étaient pas trop éloignés. Afin de prouver que l'organisme de réglementation avait une obligation de diligence envers elle, Ernst devait démontrer que le préjudice survenu était raisonnablement prévisible et montrer si des facteurs de politique publique compensatoires pesaient contre la conclusion d'une obligation de diligence. La Cour du Banc de la Reine de l'Alberta et la Cour d'appel de l'Alberta ont conclu que cette procédure était prescrite par la loi applicable et ont également conclu qu'à titre subsidiaire, l'ERCB n'avait pas d'obligation de diligence envers Ernst en partie à cause de la difficulté de la prise en compte des préoccupations individuelles dans un dispositif réglementaire public complexe. (on peut observer que Ernst a interjeté appel de la décision auprès de la Cour suprême du Canada au motif que l'ERCB avait violé ses droits à la liberté d'expression en vertu de l'article 2(b) de la Charte, cet article de la Charte étant discuté dans la Section IV ci-dessous.)
Le droit constitutionnel
Il y a eu également diverses tentatives pour porter des causes d'action environnementales sous l’égide du droit constitutionnel.
Le premier type de problème est qu'un niveau de gouvernement vis-à-vis d'un autre niveau de gouvernement n'a pas le pouvoir d'entreprendre un type d'action spécifique, ce qui fait que l'action est inconstitutionnelle. La doctrine de l'Immunité Interjuridictionnelle soutient qu'une loi provinciale ne peut pas réglementer un domaine fédéral dans son essence.96 La doctrine de la Prépondérance soutient que si deux textes législatifs adoptés de manière valide entrent en conflit, alors la loi fédérale est prépondérante.97 La plupart de ces affaires concerne des projets d'infrastructure fédéraux, tels que des pipelines interprovinciaux, qui relèvent de la compétence fédérale en vertu des articles 91(29) et 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1897. Néanmoins, les provinces ont le droit de réglementer l'environnement à l'intérieur de leurs propres frontières. Par exemple, dans Coastal First Nations c. Colombie-Britannique, le tribunal de première instance de la Colombie-Britannique a statué que le système d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique était intra vires vis-à-vis de la province et pourrait valablement s'appliquer à un pipeline interprovincial. Cependant, le tribunal a noté que la province ne serait pas en mesure d'utiliser le système pour bloquer entièrement le projet du pipeline.98
À titre d'exemple supplémentaire, la Colombie-Britannique a modifié sa Loi de gestion de l'environnement (Environmental Management Act) pour interdire à quiconque de transporter du pétrole lourd sans permis, mais les permis ne s'appliquent qu'aux volumes additionnels. Ces modifications étaient largement considérées comme une mesure politique visant à arrêter l'expansion d'un pipeline transportant du pétrole brut de l'Alberta vers les côtes de la Colombie-Britannique. Cependant, les pipelines qui traversent les frontières provinciales relèvent de la compétence fédérale. Le gouvernement fédéral a fait valoir, avec succès, que le but de ces modifications à la loi était de contrecarrer la construction du pipeline. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a statué que, bien que la province et le gouvernement fédéral aient autorité sur le pipeline, les modifications visaient, en essence et en substance, à réglementer la matière fédérale et étaient donc inconstitutionnelles.99 La Cour suprême du Canada a adopté les motifs de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
Le deuxième type de contestation est une plainte déposée en vertu de la Charte. Ces types de contestations sont un moyen imparfait de plaider des revendications environnementales car la Charte n'énumère aucun droit environnemental, comme nous l'avons vu dans la Section I. Enfin, il existe des protections spécifiques confiées aux Premières Nations en vertu de l'article 35 de la Constitution canadienne, qui affirme et reconnaît les droits ancestraux et les droits issus de traités. En règle générale, les Premières Nations peuvent demander un contrôle judiciaire des décisions gouvernementales qui ne tiennent pas suffisamment compte des droits ancestraux et des droits issus de traités.100 Les revendications fondées sur la Charte et celles relatives aux droits ancestraux et aux droits issus de traités sont examinées plus en détail dans la Section I.
B. Quelles règles de qualité pour agir s'appliquent dans les affaires environnementales ?
La « qualité pour agir » est le terme juridique désignant la capacité d'une personne à porter une affaire devant un tribunal.
La qualité pour agir individuelle
Le système canadien de litige civil est fondé sur la norme de « qualité privée » ou « qualité de plein droit », ce qui signifie qu'un individu pourra se présenter devant le tribunal pour soulever un grief qui lui est personnel. Un tribunal déterminera si une personne a qualité pour agir conformément au droit coutumier (common law) ou à toute législation applicable qui remplace les règles de la common law. En vertu de la common law, le contentieux doit être justiciable et le demandeur doit être légitime (c'est-à-dire avoir subi un préjudice).
(a) Le contentieux doit être justiciable :
Cet élément a été notoirement difficile à établir dans les revendications environnementales. Un examen de la jurisprudence révèle certaines similitudes importantes dans la façon dont les tribunaux évaluent si une affaire est justiciable en considérant deux critères dominants : la légitimité et la capacité.
Les problèmes de légitimité sont intimement liés à la séparation des pouvoirs et à l'idée générale que certaines affaires ne sont pas justiciables en raison de leur nature politique.101 Dans le cas de Les Amis de la Terre c. le Canada, la Cour fédérale a été priée d'examiner le non-respect par le gouvernement de ses propres engagements en vertu de la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto pour préparer un plan climatique et publier des propositions de modifications réglementaires pour répondre à ses engagements. Les tribunaux ont été sensibles à leur rôle d'arbitres judiciaires et ont déclaré la demande non justiciable pour des raisons de politique publique.
Les problèmes de capacité sont liés au principe selon lequel les droits environnementaux sont essentiellement des droits sociaux et économiques. Ainsi, les tribunaux estiment-ils qu'ils « manquent de capacité » et d'expertise pour statuer de manière correcte. La Cour a jugé l'affaire de Tanudjaja c. le Procureur général (Canada) non justiciable parce qu'elle impliquait des droits positifs qui, selon la Cour, n'étaient pas reconnus en droit canadien. Cette non-acceptance des droits économiques et sociaux est intimement liée à la question des obligations positives. Étant donné que les droits environnementaux ne sont pas clairement énoncés dans la législation canadienne et que de nombreuses affaires environnementales sont présentées comme un droit positif, ayant une incidence sur les droits sociaux et économiques (droits à l'air, à un environnement propre, à une eau propre), les tribunaux canadiens ont tendance à éviter d'intervenir. Les tribunaux préfèrent davantage traiter les réclamations qui contestent l'ingérence du gouvernement dans les droits et sont réticents à s'engager dans des réclamations qui impliquent des obligations positives pour le gouvernement d'agir et de protéger les droits. En insistant sur le fait que les réclamations environnementales doivent être liées à une contestation d'un instrument spécifique, les tribunaux échouent souvent à reconnaître la nature diffuse des dommages environnementaux, ce qui rend l'obstacle de la justiciabilité difficile à surmonter.102
(b) Le demandeur doit être légitime :
En ce qui concerne les individus, leurs droits doivent être impactés. D'habitude, les demandeurs doivent être directement touchés ou avoir un véritable intérêt dans l'affaire.
Certaines lois fixent des exigences de qualité pour agir spécifiques. Par exemple, en vertu de l'ancienne Loi sur la conservation des ressources énergétiques (Energy Resources Conservation Act), un demandeur qui se réclame comme étant qualifié pour agir doit démontrer qu'il est « directement et négativement » affecté. En 2009, Kelly et autres se sont réclamés comme étant qualifiés pour contester une décision de l'organisme de réglementation de positionner des puits de gaz corrosif à proximité de leur propriété. L'organisme de réglementation avait conclu que les demandeurs n'avaient pas de qualité pour agir. La Cour d'appel a réfuté cette décision, en concluant qu'ils détenaient en fait la qualité pour agir et en ordonnant à l'organisme de réglementation de convoquer une nouvelle audience pour imposer des limites appropriées aux puits en raison de la proximité des demandeurs avec les puits et des potentiels rejets dangereux.103 On notera que selon la décision d'autorisation d'appel, le juge a estimé sua sponte que les requérants avaient satisfait au critère d'autorisation d'appel au motif que leurs droits garantis par l'article 7 avaient été violés.104
La règle de la Nuisance Publique définit que le plaideur légitime est le gouvernement vis-à-vis du procureur général, et que les parties civiles peuvent intenter une action en justice pour faire respecter les droits publics seulement si leurs propres droits personnels sont enfreints.105 Les parties civiles peuvent également intenter une action si le défendeur est le gouvernement.
Ces principes ont été appliqués pour réfuter la qualité pour agir aux plaignants cherchant à faire appliquer diverses lois environnementales, y compris les organisations environnementales. En particulier, les tribunaux préfèrent toujours que le procureur général engage des poursuites qui affectent l'intérêt public.106 De plus, le tribunal a tendance à examiner les termes de la loi pour déterminer l'étendue de la participation du public à l'application de la législation.107 Ce problème est particulièrement épineux en raison de l'ampleur de la réglementation sur l'environnement.
La qualité pour agir dans l'intérêt public
La qualité pour agir dans l'intérêt public est un aspect de la loi sur la qualité pour agir qui permet aux individus et aux organisations de porter des affaires d'intérêt public devant les tribunaux, même si leurs propres droits individuels ne sont pas violés et même s'ils ne sont pas directement impliqués dans l'affaire.
La Cour suprême a établi un test en trois parties (Le test Downtown Eastside) pour accorder la qualité pour agir dans l'intérêt public dans l’affaire le Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society [2012] CSC 45.
Dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire en matière de qualité pour agir, les tribunaux évalueront :
Si l'affaire soulève une question justiciable grave ;
Si la partie intentant l'action a un véritable enjeu ou un intérêt réel dans son dénouement ; et
Si, compte tenu d'un certain nombre de facteurs, la poursuite proposée est un moyen raisonnable et efficace de porter l'affaire devant les tribunaux.
Une décision récente sur la qualité pour agir dans l'intérêt public est le Procureur général de la Colombie-Britannique c. Conseil des Canadiens avec déficiences [2022].108 La Cour s'est appuyée sur le test Downtown Eastside énoncé ci-dessus, et « a soupesé cumulativement » les trois critères. En appel, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a souligné deux autres principes guidant les tribunaux dans l'application du test en trois parties, à savoir :
- Le principe de légalité : ce principe reflète l'idée que « les actes de l'État doivent être conformes à la Constitution [et à l'autorité statutaire] et ne doivent pas être à l'abri d'un examen judiciaire », c'est-à-dire qu'il doit exister un moyen pratique et efficace de contester la légalité de l'action de l'État devant les tribunaux (Conseil des Canadiens avec déficiences, Cour d'appel de la Colombie-Britannique, par. 73).109
- L'accès à la justice : ce deuxième principe devrait guider la Cour afin qu'elle examine « les réalités pratiques lorsqu’il s’agit d’assurer l’accès à la justice pour les citoyens vulnérables et marginalisés qui sont grandement touchés par une loi dont la validité constitutionnelle est contestable » (Conseil des Canadiens avec déficiences, Cour d'appel de la Colombie-Britannique, par. 71).110
La Cour a estimé que ces deux principes étaient des « éléments clés » auxquels « il convient d'accorder [...] une importance particulière » lorsqu'il s'agit de décider de reconnaître ou non la qualité pour agir dans l'intérêt public.111 Néanmoins, les tribunaux ne seront pas rigoureusement stricts dans leur interprétation de ces principes si, en réalité, cela imposerait un obstacle supplémentaire aux demandeurs cherchant à obtenir la qualité pour agir dans l'intérêt public. Au Canada, on présume que les tribunaux sont ouverts et accessibles. Donc, les tribunaux appliqueront de manière équilibrée le test Downtown Eastside, ainsi que les principes de légalité et d'accès à la justice, et chercheront à prendre des décisions justes et contextuelles sur l'opportunité de reconnaître ou de nier la qualité pour agir dans l'intérêt public.112
Par exemple, dans Procureur général de la Colombie-Britannique c. Conseil des Canadiens avec déficiences [2022],113 la Cour suprême a décidé que la présence d'un demandeur directement concerné ne devrait pas être une condition stricte pour accorder la qualité pour agir dans l'intérêt public. La Cour a examiné d'autres options efficaces, telles que les preuves fournies par les témoins non-demandeurs concernés et les experts pertinents, sur lesquelles les plaideurs agissant dans l'intérêt public peuvent s'appuyer pour fournir le cadre factuel nécessaire lors de la poursuite d'une action d'intérêt public.114
La Cour fédérale du Canada autorise les recours collectifs, comme le font chacune des provinces et chacun des territoires.115
L'Environmental Law Centre a sondé la qualité pour agir dans l'intérêt public dans diverses juridictions canadiennes et a constaté qu'il y avait une réticence judiciaire à reconnaître la qualité pour agir dans l'intérêt public aux défenseurs de l'environnement en Alberta, alors que les Cours fédérales étaient moins réticentes (pour en savoir plus sur les tendances législatives et judiciaires en matière de protection de l'environnement, voir la section 1.D).116
C. Ces règles de qualité pour agir diffèrent-elles lorsque des enfants sont les plaignants et, si tel est le cas, de quelle manière ?
Les enfants doivent avoir un tuteur ad litem117 qui est censé effectuer les mesures nécessaires pour garantir que les intérêts de l'enfant soient protégés de la meilleure façon possible. Un enfant peut demander au tribunal de renoncer à l'exigence d'un tuteur ad litem à la discrétion du juge.
Les règles diffèrent dans chaque province/territoire :
- En Alberta, les personnes âgées de moins de 18 ans « doivent avoir un représentant à l'instance pour intenter ou défendre une action, ou pour poursuivre ou participer à une action, ou pour qu'une action soit intentée ou poursuivie contre elles », sauf ordre contraire d'un tribunal.118 Dans le cas où cette personne âgée de moins de 18 ans serait un « conjoint ou partenaire indépendant majeur » au sens de la loi applicable, l'article susmentionné ne s'applique pas.119 Les Règles ajoutent que : « Un enfant ne peut pas être considéré comme participant à une procédure aux fins de la règle 2.11(a) par la seule raison qu'il : (a) fait l'objet d'un différend concernant la tutelle, la garde, le droit de visite, le temps parental, la responsabilité décisionnelle ou le contact, ou (b) est avisé d'une procédure en vertu d'un texte législatif qui exige qu'une personne âgée de moins de 18 ans reçoive un avis de procédure ».120 Le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse représente les enfants uniquement dans les affaires relevant de la Child, Youth and Family Enhancement Act (loi pour l'amélioration de l'enfance, de la jeunesse et de la famille) et de la Protection of Sexually Exploited Children Act (loi sur la protection des enfants victimes d'exploitation sexuelle).121
- En Colombie-Britannique, tous les « enfants en bas âge » doivent avoir un tuteur nommé à l'instance pour les affaires liées aux biens en vertu de l'Infants Act (loi sur l'enfance) RSBC (1996) ch. 223 et des Règles civiles de la Cour suprême, BC Reg 168/2009.122 Selon l'article 201 de la Loi sur le droit de la Famille, un enfant a la capacité d'intenter, de diriger ou de défendre une instance en vertu de la Loi sur le droit de la Famille sans tuteur à l'instance si l'enfant est : âgé de 16 ans ou plus, marié ou parent. Un tribunal peut toutefois nommer un tuteur à l'instance s'il l’estime nécessaire.123
- Au Manitoba, les enfants peuvent se représenter eux-mêmes ou être représentés par un avocat dans les affaires criminelles et civiles.124 Le Bureau du protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba se limite aux questions suivantes : enfance et famille, adoption, santé mentale, toxicomanie, éducation, handicap, justice et soutien aux victimes.125 Cependant, comme indiqué sur leur site Internet, le Bureau « fait [également] la promotion de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [...], [qui] énonce plus de 40 droits fondamentaux spécifiques aux enfants ».126
- Au Nouveau-Brunswick, dans les procédures civiles, « sauf ordonnance ou disposition contraire d'une loi, une procédure par ou contre une personne avec une incapacité doit être intentée, poursuivie ou défendue, dans le cas d'un mineur, par un tuteur à l'instance [...] ».127 Toute personne n’ayant pas d’incapacité peut agir comme tuteur à l'instance pour un demandeur ou un requérant sans être nommée par le tribunal.128 En revanche, « nul ne peut agir à titre de tuteur à l'instance pour un défendeur ou un intimé atteint d'incapacité » tant que cette personne n'a pas été nommée par le tribunal.129 Selon la loi, le tuteur à l'instance ou le comité « doit [...] prendre toutes les mesures pour la protection des intérêts [de l'enfant] » et « doit agir par l'intermédiaire d'un avocat et instruire cet avocat dans la conduite de la procédure ».130
- À Terre-Neuve-et-Labrador, dans les procédures civiles, les personnes avec une incapacité, y compris les enfants, « ne peuvent engager, défendre, intervenir ou comparaître dans une procédure que par leur tuteur ad litem », qui « agit par l’intermédiaire d’un avocat ».131 Une personne peut être tuteur ad litem sans être nommée par le tribunal, sauf indication contraire.132
- Aux Territoires du Nord-Ouest, selon la loi, « une partie civile à une procédure se trouvant en état d'incapacité ou agissant en qualité de représentant doit être représentée par un avocat » dans les affaires civiles.133 Le Bureau de l'avocat des enfants ne représente que les enfants impliqués dans des affaires familiales et de protection. Pour les affaires criminelles, l'aide juridique fournira un avocat, à l'exception des affaires où des enfants sont poursuivis ou veulent poursuivre quelqu'un ainsi que pour des questions relatives aux droits humains, entre autres.134
- En Nouvelle-Écosse, pour les affaires civiles, la loi prévoit la nomination obligatoire d'un conseiller juridique pour les personnes qui ont besoin d'un tuteur à l'instance.135
- Au Nunavut, dans les procédures civiles, « un mineur peut, par son représentant, poursuivre ou présenter une demande reconventionnelle » et « fait représenter sa défense par son tuteur d’instance, sauf ordonnance contraire du tribunal ».136
- En Ontario, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas intenter une action ou être poursuivis en leur propre nom dans les affaires civiles, sauf auprès de la Cour des petites créances pour une valeur de 500 $ ou moins.137 Le Bureau de l'avocat des enfants a pour obligation de fournir aux enfants une représentation (un tuteur à l'instance), notamment dans le domaine des litiges civils, qui agit à titre de tuteur à l'instance lorsqu'aucun adulte n'est disposé à représenter l'enfant. Il représente l'enfant « dans une requête en nomination d'un tuteur aux biens pour que ce tuteur reçoive et gère l'argent de l'enfant provenant de lésions corporelles ou d’une autre action civile au tribunal » ; il protège également les intérêts de l'enfant lorsqu'un tuteur à l'instance autre que l'avocat des enfants est présent.138
- À l'Île-du-Prince-Édouard, la loi stipule que les procédures civiles doivent être intentées, poursuivies ou défendues par un tuteur à l'instance au nom d'un mineur, à moins que le tribunal ou la loi n'en dispose autrement.139 La loi prévoit en outre que toute personne qui n'est pas sous tutelle peut agir en qualité de tuteur à l'instance pour un enfant plaignant ou demandeur sans être nommée par le tribunal.140 Toutefois, lorsque l'enfant est défendeur ou intimé par le tribunal, le tuteur à l'instance doit généralement être nommé par le tribunal.141
- Au Québec, en matière civile, « les représentants, les mandataires, les tuteurs, les curateurs et les autres personnes agissant pour le compte d'autrui [...] », tout comme les tuteurs et les représentants des demandeurs, « sont tenus de se faire représenter devant les tribunaux par un avocat dans les procédures contentieuses, et par un avocat ou un notaire dans les procédures gracieuses ».142 La loi prévoit en outre que : « que ce soit dans une procédure contentieuse ou non, le tribunal, même d'office, peut ordonner une représentation s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde des droits et intérêts d'un mineur ou d'un majeur non représenté par un tuteur, un curateur ou un mandataire et déclaré incapable par le tribunal ».143
- En Saskatchewan, dans le domaine civil, « un mineur peut intenter, poursuivre ou défendre une procédure comme s'il avait atteint l'âge de la majorité si [...] (b) le mineur est représenté par un avocat nommé par la Commission d'aide juridique de la Saskatchewan ; (c) avant ou après le début de la procédure, le mineur obtient l'autorisation du tribunal ».144 La loi précise en outre que « [s]ous réserve de dispositions contraires, un mineur peut engager, poursuivre ou défendre une procédure via un tuteur à l'instance ».145 Sauf ordre contraire du tribunal, « toute personne qui n'est pas frappée d’incapacité peut agir comme le tuteur à l'instance d'un mineur sans être nommée par le tribunal ».146
- Au Yukon, les enfants doivent intenter ou défendre un contentieux par l’intermédiaire d’un tuteur à l'instance, qui doit être représenté par un avocat à moins que le tuteur à l'instance ne soit le tuteur et curateur public.147 Sauf ordonnance contraire du tribunal, une personne peut être le tuteur d'un enfant sans être nommée par le tribunal.148
D. Quelles sont la charge et le niveau de la preuve pour les allégations de préjudice personnel résultant d'une exposition aux substances toxiques ?
Au Canada, pour les affaires civiles de common law, il incombe au demandeur de prouver les éléments du délit selon la prépondérance des probabilités.149
E. Quels sont les délais de prescription dans les affaires environnementales ?
Pour les actions en responsabilité délictuelle, le délai de prescription varie selon la province. Pour les contentieux fondés sur l’application d'une loi, le délai de prescription est généralement fixé par la loi. En Alberta, par exemple, l'article 3 de la Loi de 2000 sur la prescription des actions prévoit un délai de prescription de deux ans, mais en vertu de l'article 218 de la Loi sur la protection et l'amélioration de l'environnement, un tribunal peut prolonger un délai de prescription « lorsque la raison de la procédure se trouve être un effet négatif présumé résultant du rejet présumé d'une substance dans l'environnement. » En Ontario, la Loi de 2002 sur la prescription des actions de l'Ontario prévoit de même qu'une revendication environnementale doit être déposée dans les deux ans suivant sa découverte. En général, le délai de prescription commence lorsque les faits sous-jacents deviennent découvrables ou lorsqu'ils auraient dû être découverts. La plupart des juridictions ont également un statut de repos et suspendent les délais de prescription pour les mineurs.
| Province | Loi | Délai de prescription général | Délai de prescription ultime | Dispositions particulières pour les mineurs |
| Colombie-Britannique | Loi sur la prescription, SBC, 2012, ch. 13 | 2 ans à compter de la découverte de la cause d'action, art. 6(1). | 15 ans à compter de la survenance de la cause d'action, art. 21(1). | Sauf mentions particulières, le délai de prescription s'étend sur 2 ans à compter du 19ème anniversaire du mineur. art.18. |
| Alberta | Loi sur les prescriptions, RSA, 2000, ch. L-12 | 2 ans à compter de la découverte de la cause d'action, art. 3(1)(a). | 10 ans à compter de la survenance de la cause d'action, art. 3(1)(b). | Le délai de prescription s'étend sur 2 ans à compter du 18ème anniversaire du mineur. |
| Saskatchewan | Loi sur les prescriptions, SS, 2004, ch. L-16.1 | 2 ans à compter de la survenance de la cause d'action. | 15 ans. | Le délai de prescription s'étend sur 2 ans à compter du 18ème anniversaire du mineur. |
| Manitoba | Loi sur la prescription des actions, CPLM, ch. L150 | 2 ans pour les dommages aux biens mobiliers et 6 ans pour les dommages aux biens immobiliers, à compter de la survenance de la cause d'action, art. 2(1)(g). | 30 ans à compter de la survenance de la cause d'action, art. 14(4). | Le délai de prescription s'étend sur 2 ans à compter du 18ème anniversaire du mineur. |
| Ontario | Loi sur les prescriptions, LO, 2004, ch. 31 | 2 ans à compter de la découverte de la cause d'action, art. 4 et 5. | 15 ans (à compter de la survenance de la cause d'action), art. 15. | Le délai de prescription s'étend sur 2 ans à compter du 18ème anniversaire du mineur. |
| Québec | Code civil du Québec, LQ, 1991, ch. 64 | 3 ans à compter de la prise d'effet du droit d'action, art. 2925. | n.c. | n.c. |
| Nouveau-Brunswick | Loi sur la prescription des actions, LN-B, 2009, ch. L-8.5 | 2 ans. | 15 ans. | Le délai de prescription s'étend sur 2 ans à compter du 19ème anniversaire du mineur. |
| Nouvelle-Écosse | Nouvelle loi sur la prescription des actions (en vigueur depuis le 1er septembre 2015) | 2 ans, par. 8(1)(a). | 15 ans, par. 8(1)(b). | Le délai de prescription s'étend sur 2 ans à compter du 19ème anniversaire du mineur. |
| Île-du-Prince-Édouard | Loi sur les règles relatives à la prescription, RSPEI, 1988, ch. S-7 | 6 ans à compter de la survenance de la cause d'action, art. 2(1)(g). | n.c. | Le délai de prescription s'étend sur 2 ans à compter du 18ème anniversaire du mineur. |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Loi sur les prescriptions, SNL, 1995, ch. L-16.1 | 2 ans à compter de la découverte de la cause d'action, art. 5(b) ; 13 ; 14. | 10 ans à compter de la survenance de la cause d'action, art. 14(3). | Le délai de prescription s'étend sur 2 ans à compter du 19ème anniversaire du mineur. |
| Yukon / Territoires du Nord-Ouest / Nunavut | Loi sur la prescription des actions, LRY, 2002, ch. 139 | 6 ans à compter de la survenance de la cause d'action, art. 2(1)(e), (f). | n.c. | Le délai de prescription s'étend sur 2 ans à compter du 19ème anniversaire du mineur. |
F. Une aide juridique est-elle accessible dans les affaires environnementales ? Si oui, dans quelles circonstances ?
L'aide juridique fait généralement référence au financement fourni par les gouvernements provinciaux soit aux avocats soit aux cliniques juridiques. Vous trouverez ci-dessous une liste des divers programmes d'aide juridique disponibles :
Colombie-Britannique
- Legal Aid BC
- Law Students' Legal Advice Program (LSLAP) - Université de la Colombie-Britannique
- West Coast Environmental Law - aide juridique
Alberta
- Law Central Alberta - base centralisée pour les cliniques d'aide juridique de l'Alberta
- Public Interest Law Clinic - Université de Calgary
- Le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse - peut être en mesure de fournir du soutien, des suggestions et des conseils sur l'accès à un avocat.
Saskatchewan
Manitoba
- Legal Aid Manitoba, Public Interest Law Centre
- Rights Clinic, Faculté de droit de l'Université du Manitoba
- Le Bureau du protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba (Manitoba Advocate for Children and Youth) - son champ d’action se limite aux questions d'adoption d'enfants et de familles, à la santé mentale, à la toxicomanie, à l'éducation, au handicap, à la justice et à l'aide aux victimes. Cependant, comme indiqué sur son site Internet, il « fait [également] la promotion de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [...], [qui] énonce plus de 40 droits humains spécifiques aux enfants ».
Québec
- Centre québécois du droit de l'environnement - ressources/conseils pour les ONG
- Aide Juridique de Montréal - aide juridique
Ontario
- Association canadienne du droit de l'environnement (Canadian Environmental Law Association) - financement par Legal Aid Ontario
- Le Bureau de l'avocat des enfants (Office of the Children’s Lawyer) - son mandat comprend la représentation des enfants (un tuteur à l'instance) en matière de litige civil, entre autres.
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
- Pro Bono Legal Advice Clinic for Self-Represented Litigants - les conseils sont limités aux affaires civiles et familiales devant la Cour suprême de l'Î.-P.-É. et la Cour d'appel de l'Î.-P.-É.
- Legal Aid Services and Support - programmes d'accès à la justice
Terre-Neuve-et-Labrador
- Legal Aid Services and Support - axé sur le droit de la famille et le droit pénal
Yukon / Territoires du Nord-Ouest / Nunavut
- Yukon Legal Services Society - aide juridique
- Ministère de la Justice du Yukon - coordonnateur de la justice communautaire des travailleurs autochtones auprès des tribunaux
- Conseil des Premières Nations du Yukon - programmes de justice
- Commission d'aide juridique des Territoires du Nord-Ouest
- Travailleurs des tribunaux communautaires
- Commission des services juridiques du Nunavut
- Le Bureau de l'avocat des enfants (Office of the Children's Lawyer) ne représente que les enfants impliqués dans des affaires familiales et de protection de l’enfance. Pour les affaires criminelles, Legal Aid fournit un avocat, à l'exception des affaires où des enfants sont poursuivis ou veulent poursuivre quelqu'un ou pour des cas soulevant des questions de droits humains notamment.
- West Coast Environmental Law offre des subventions d'aide juridique par l'intermédiaire de l'Environmental Dispute Resolution Fund, et le financement provient de la Law Foundation of British Columbia.150
- Le Pacific Center for Environmental Law and Litigation est un organisme de bienfaisance à but non lucratif axé sur les litiges environnementaux, mais il ne plaide pas ses propres affaires.151
- Ecojustice est une association environnementale à but non lucratif qui ne plaide que sur des affaires environnementales, mais elle est entièrement financée par des dons privés.152
- East Coast Environmental Law propose des informations juridiques, des ressources éducatives, des références d'avocats et d'autres formes de soutien aux groupes communautaires, aux organisations à but non lucratif et aux membres du public qui se retrouvent confrontés à des questions de droit de l'environnement.153
III. Réparations juridiques
A. Quelles réparations juridiques peuvent être imposées par les tribunaux dans les affaires environnementales ?
Les recours civils / de common law
Comme mentionné dans la section II ci-dessus, les tribunaux imposent une compensation financière comme réparation pour les actions intentées en droit de responsabilité délictuelle, sur des sujets tels que la nuisance, l'intrusion et la négligence.
Les tribunaux sont également habilités à accorder des injonctions provisoires au cours d'une action civile, pour empêcher une des parties de poursuivre une activité qui peut causer, ou cause effectivement, des dommages au plaignant qui demande réparation. Les droits du plaignant en common law doivent être touchés par les actions ou omissions de l'intimé d'une manière distincte et particulière. Les injonctions provisoires ne sont donc pas souvent accordées pour les affaires d'intérêt public, à moins que le tribunal n'exerce son pouvoir discrétionnaire pour le faire.154
La propension des juridictions d'exercer leur pouvoir discrétionnaire de cette manière diffère d'une province à l'autre ; par exemple, au Québec, les tribunaux ont appliqué le critère des injonctions provisoires aux questions d'intérêt public soulevées par des individus ou des groupes, en utilisant l'effet combiné des articles 55 et 59 du Code de procédure civile (le « CPC »).155 De plus, l'article 752 du CPC156 a été utilisé par les tribunaux pour accorder une réparation provisoire lorsqu'un demandeur semble y avoir droit et qu'il est nécessaire d'éviter un préjudice ou une situation irréparable à laquelle la décision finale n'a pas pu remédier.157
Recours constitutionnels : la répartition des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les provinces
Les tribunaux ont également le pouvoir de confirmer ou d'infirmer les décisions du gouvernement fédéral d'intervenir dans les affaires provinciales et de décider de la compétence provinciale.158 Par exemple, le gouvernement de la Saskatchewan a contesté la constitutionnalité de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES) promulguée par le gouvernement fédéral.159 Des contestations constitutionnelles similaires ont été intentées en Ontario et une autre en Alberta, de sorte que la Cour suprême du Canada a entendu les affaires ensemble.160 La Cour suprême du Canada a conclu que la LTPGES est constitutionnelle en tant que question d'intérêt national - des questions qui, de par leur nature, transcendent les provinces - en vertu de la clause concernant la paix, l'ordre et la bonne gouvernance énoncée de l'article 91 de la Constitution du Canada. Cela signifie que le gouvernement fédéral a en dernier recours le pouvoir d'intervenir lorsqu'une province ne parvient pas à lutter efficacement contre les changements climatiques.161
Recours constitutionnels : les recours en vertu de la Charte
Les tribunaux ont le pouvoir d'annuler les lois qui sont inconstitutionnelles en vertu de l'article 52 de la Charte : « La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada ; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit ».162
Les tribunaux peuvent également prévoir des réparations personnelles ou autres en vertu de l'article 24(1) de la Charte pour des actions gouvernementales inconstitutionnelles.163 Un demandeur cherchant une réparation en vertu de l'article 24(1) de la Charte doit tenir compte de ce qui suit :
- Les droits du demandeur doivent être enfreints ou niés. Il s'agit d'une exigence de qualité pour agir plus stricte que celle applicable à de nombreux recours de common law.
- L'article 24(1) a été utilisé comme recours lorsque l'on craignait qu'une infraction puisse se produire à l'avenir. Dans R c Demers,164 la Cour suprême du Canada a accordé au Parlement un délai d'un an pour remplacer les dispositions du Code criminel relatives aux accusés inaptes à passer en jugement.165 Il est également significatif que ce recours ait été utilisé contre le Parlement. Dans cette affaire, le tribunal a également déclaré invalides certaines dispositions du Code criminel. Bien qu'il ne s'agisse pas spécifiquement d'une affaire environnementale, cela souligne les pouvoirs en vertu de la Charte conférés à la Cour pour justifier de tels recours.
- Les cours supérieures de chaque province ont compétence pour entendre les demandes en vertu de l'article 24(1), nonobstant la question de la compétence des autres tribunaux. La Cour en question devra déterminer si la demande est conforme à son mandat, à sa fonction et à sa structure.166
- Des dommages-intérêts peuvent être accordés s’ils servent un but fonctionnel afin de remédier à une violation de la Charte. Un demandeur devrait démontrer que les dommages-intérêts servent un ou plusieurs des objectifs généraux de la Charte :
- Indemnisation - pour réparer la perte personnelle du demandeur ;
- Revendication - pour montrer l'importance de faire respecter les droits de la Charte ; et/ou
- Dissuasion (de nouvelles infractions).167
- Un jugement déclaratoire est également disponible en vertu de l'article 24(1) - comme ci-dessus, où la législation peut être déclarée invalide avec la Charte.168
- Une injonction est également disponible en vertu de l'article 24(1), décrite dans Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (ministre de l'Éducation)169 comme élément central des recours prévus à l'article 24(1).170
Les recours statutaires
En vertu de la Loi canadienne de 1999 sur la protection de l'environnement (« LCPE »),171 le tribunal peut imposer, comme sanction pour manquement, une amende pouvant s'élever jusqu'à un million de dollars canadiens pour chaque jour où l'infraction se poursuit. Le tribunal peut également condamner le contrevenant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, en tenant compte des critères de détermination de la peine inclus dans la LCPE. En outre, le tribunal peut imposer une amende égale à tout profit réalisé résultant de l'infraction, ou bien il peut ordonner le paiement des frais de nettoyage.172
B. Quelles réparations ont à ce jour été ordonnées par les tribunaux dans des affaires environnementales ?
La jurisprudence environnementale au Canada ne montre pas souvent que les tribunaux accordent des dommages-intérêts punitifs ou réparateurs, mais se concentre davantage sur la délégation des pouvoirs fédéraux et provinciaux en matière de réglementation environnementale.
Les tribunaux canadiens semblent plus enclins à statuer sur les affaires axées sur la délégation des pouvoirs fédéraux et provinciaux en matière de réglementation environnementale, plutôt que sur celles accordant des dommages-intérêts punitifs ou réparateurs, des ordonnances de nettoyage ou des injonctions.
La Cour suprême est restée particulièrement silencieuse dans des affaires récentes relatives à la délégation des pouvoirs fédéraux et provinciaux en matière de réglementation environnementale. Par exemple, elle a déféré à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire Renvoi relatif à la Loi de 2020 sur la gestion de l'environnement.173 Il est possible d'en trouver un autre exemple dans l’affaire Canadian Plastic Bag Association v. Victoria (City).174 Dans cette affaire, la ville de Victoria a interjeté appel devant la Cour suprême après que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique avait statué qu'un règlement interdisant aux épiceries d'offrir ou de vendre des sacs en plastique aux acheteurs devait être approuvé au niveau provincial. La Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation d'appel de la ville de Victoria, et, bien que ce soit la coutume, elle n’a pas motivé sa décision.175 Les cours provinciales se sont généralement montrées disposées à intervenir dans de telles affaires. Dans l’affaire Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Cour a déclaré la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre comme constitutionnellement valide.176 Cette Loi a établi, entre autres mesures, des normes nationales minimales de rigueur des prix pour les émissions de gaz à effet de serre.
À ce jour, les tribunaux canadiens n'ont pas accordé de dommages-intérêts punitifs ou réparateurs, d'ordonnances de nettoyage, ni d'injonctions dans des affaires environnementales. Cependant, les affaires en cours, une fois tranchées, pourraient faire un peu de lumière sur l'approche des tribunaux canadiens à l'égard de tels réparations.
C. Existe-t-il des autorités administratives habilitées à donner suite aux plaintes en matière d'environnement et si oui, comment sont-elles habilitées à répondre aux plaintes ?
En vertu de la LCPE, le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé sont habilités à fournir des avis, des ordonnances et des permis.177 Les plaintes peuvent être transmises par courriel ou par téléphone à l'organisme compétent en matière d'Environnement et de Changement climatique du Canada178 de chaque province. Par exemple :
- au Québec : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDEP) - Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) ;179
- en Alberta : Environment and Parks (AEP) - Energy & Environmental Response Line ;180
- en Colombie-Britannique : ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, Ombudsman pour les plaintes relatives à la santé181 et Service d'agent de conservation pour des questions environnementales plus larges.182
Le Comité permanent de l'environnement et du développement durable procède à l'examen de la législation environnementale. Le Comité a tenu compte des commentaires de groupes et de particuliers pour son examen de la LCPE en 2016.183
Le Comité consultatif national (CCN) en vertu de la LCPE est le principal forum intergouvernemental dont le but est de permettre le bon déroulement des actions nationales et d'éviter la duplication des activités réglementaires entre les gouvernements. Le Comité communique avec le public à propos de ses mesures, par exemple, par téléconférence.
IV. Les droits civils et politiques
La liberté de réunion pacifique
A. Comment le droit des enfants de participer à des réunions pacifiques, y compris à des manifestations, est-il protégé par la législation nationale ?
En vertu de l'article 2 (c) de la Charte, les enfants ont le droit à la liberté de réunion pacifique. Bien que d'autres protections n'aient pas été élaborées par la jurisprudence, la Cour suprême a fait référence collectivement aux libertés de l'article 2 comme des droits fondamentaux de la société démocratique libérale du Canada.184
L'article 15(1) de la Convention internationale des droits de l'enfant, telle que ratifiée par le Canada le 12 décembre 1991, (la « CIDE ») stipule que : « Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique ».
B. Existe-t-il des restrictions légales au droit de l'enfant de participer à des réunions pacifiques ?
Il n'y a aucune référence à des limites d'âge ou à d'autres restrictions ni dans la Charte ni dans la CIDE. L'article 15 (2) de la CIDE stipule que : « L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui ». Ce domaine n'a pas été développé par la jurisprudence au Canada.
C. Quelles sanctions peuvent être imposées aux enfants qui participent à des grèves scolaires ?
Les lois sur l'absentéisme scolaire diffèrent selon les provinces, mais, selon la loi au Canada, tous les enfants doivent aller à l'école à partir de l'âge de 5 ou 6 ans jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 16 à 18 ans. Les écoles et les autorités canadiennes semblent cependant avoir adopté une approche encourageante envers les enfants qui s'engagent dans des grèves scolaires liées au climat. Lors des grèves pour le changement climatique en 2019, les écoles, les collèges et les universités ont suspendu tout ou partie des cours pour la journée, et le gouvernement de la ville de Toronto avait encouragé le personnel à prendre une journée de congé.185
La liberté d'expression
A. Comment le droit des enfants à la liberté d'expression est-il protégé par la législation nationale ? Existe-t-il des protections dans la Constitution nationale, dans la loi ou établies par la jurisprudence ?
En vertu de l'article 2(b) de la Charte, les enfants ont droit à « la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ».186 Les valeurs qui sous-tendent l'article 2(b) sont triples : (i) rechercher et atteindre la vérité ; (ii) encourager la participation aux prises de décision sociales et politiques ; et (iii) cultiver la diversité dans l'épanouissement tant individuel qu'humain dans un environnement tolérant et accueillant.187
L'article 2(b) protège « l'activité qui transmet ou tente de transmettre une signification ».188 Par conséquent, la liberté d’« expression » ne se limite pas aux mots. Cela inclut toute activité physique qui est utilisée pour transmettre ou tenter de transmettre une signification.189 La jurisprudence a confirmé que l'expression protégée en vertu de l'article 2(b) inclut des activités courantes associées aux manifestations et aux campagnes environnementales des enfants : par exemple, défiler avec des banderoles ;190 afficher et distribuer des enseignes,191 des dépliants,192 des affiches (y compris les affiches placées sur le domaine public) ;193 et le bruit émis par un haut-parleur.194
La Cour suprême a adopté un test en trois parties pour déterminer si l'expression relève des protections prévues à l'article 2(b) de la Charte : (1) l'activité a-t-elle un contenu expressif, ce qui l'insère prima facie dans le champ d'application de l'article 2(b) ; (2) l'activité est-elle exclue en raison de l'emplacement ou de la méthode d'expression ; et (3) si l'activité est protégée, une violation du droit protégé résulte-t-elle de l’objet ou de l'effet de l'action gouvernementale ?195
Le droit à la liberté d'expression est en outre protégé par l'article 13 de la CIDE.196 L'article 13 reconnaît un droit plus large à la liberté d'expression qui comprend « la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant ». L'article 1(d) de la Déclaration canadienne des droits197 et les instruments juridiques internationaux régissant le Canada, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques198 et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, prévoient en outre le droit de l'individu à la liberté d'expression.199
B. Existe-t-il des limites ou des restrictions légales au droit à la liberté d'expression qui s'appliquent spécifiquement aux enfants ?
Il ne semble pas exister de limitations expresses au droit d’expression qui s'appliquent spécifiquement aux enfants. Les droits inscrits dans la Charte s'appliquent également aux enfants,200 et l'âge n'est pas un facteur limitatif. Toute limitation des droits de l'individu en vertu de l'article 2(b) doit être justifiée en vertu de l'article 1, qui prévoit que les droits et libertés garantis par la Charte ne seront assujettis qu'aux « limites raisonnables prescrites par la loi et dont la justification peut être démontrée dans une société libre et démocratique ».201 De plus, comme les protections prévues par la Charte s'appliquent à tous les Canadiens, il existe un risque de conflit entre les droits de l'enfant (c'est-à-dire le droit d'un enfant de participer à une activité d'expression) et les droits du parent de prendre des décisions au nom de l’enfant.
La CIDE prévoit que l'article 13 ne peut être restreint que dans la mesure prévue par la loi et si cela est nécessaire pour faire respecter les droits ou la réputation d'autrui ou pour protéger la sécurité nationale, l'ordre social, la santé publique ou les mœurs.202
La liberté d'association
A. Comment le droit des enfants à la liberté d'association est-il protégé par la législation nationale ? Existe-t-il des protections dans la Constitution nationale, dans la loi ou développées par la jurisprudence ?
Le droit des enfants à la liberté d'association est défini comme une « liberté fondamentale » en vertu de l'article 2(d) de la Charte203 et est reconnu par l'article 15 de la CIDE.204 Il existe également une gamme d'instruments juridiques internationaux qui lient le Canada pour mieux protéger le droit de l'individu à la liberté d'association.205 La liberté d'association est souvent associée à la liberté de réunion pacifique qui est protégée par l'article 2(c) de la Charte (voir la discussion sur la liberté de réunion pacifique à la section IV ci-dessus).
La portée et l'objet de l'alinéa 2(d) ont été définis par la jurisprudence.206 En 2015, la Cour Suprême a conclu que l'alinéa 2(d) de la Charte protège trois catégories d'activités. Premièrement, le droit « constitutif » de constituer des associations. Deuxièmement, le droit « déductif » à l'activité associative pour poursuivre d'autres libertés constitutionnelles. Troisièmement, le droit « téléologique » à l'activité collective qui permet « aux personnes vulnérables et inefficaces de faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la force de ceux avec qui leurs intérêts interagissent ou entrent en conflit ».207 Cette formulation du droit à la liberté d'association a fait l'objet de certaines critiques académiques et judiciaires. Cependant, il est généralement reconnu que le droit à la liberté d'association protège la liberté des individus de former des associations dans la poursuite d'objectifs communs.208
L'alinéa 2(d) de la Charte reconnaît « la nature sociale profonde des entreprises humaines » et vise à « protéger l’individu contre tout isolement imposé par l'État dans la poursuite de ses fins ».209 Ce droit a pour fonction de « protéger l'action collective de personnes en vue de réaliser des objectifs communs »,210 permettant ainsi aux individus d’être protégé « devant des entités plus puissantes » et de donner aux groupes vulnérables les moyens de contrebalancer les inégalités de la société.211 Son objectif est de « permet[tre] l'épanouissement individuel au moyen de relations interpersonnelles et de l’action collective ».212
B. Existe-t-il des limites ou des restrictions légales au droit à la liberté d'association qui s'appliquent spécifiquement aux enfants ?
Il ne semble pas y avoir de limitations expresses au droit d'association qui s'appliquent spécifiquement aux enfants. Comme indiqué, les droits inscrits dans la Charte s'appliquent également aux enfants, et l'âge n'est pas un facteur limitatif. Le droit à la liberté d'association protège l'association politique et comprend le droit d'être libre de toute association forcée.213
Cependant, même s'il est interdit à l'État d'interférer avec le droit de l'individu de se réunir ou de former des associations, l'État peut interférer avec les activités menées par les associations que les individus forment.214 Par exemple, les activités associatives qui comprennent de la violence seront interdites.215 Dans tous les cas, toute interférence avec les droits d'un individu en vertu de l'alinéa 2d) doit être justifiée en vertu de l'article 1 de la Charte.216 De même, l'article 15(2) de la CIDE établit qu'aucune restriction autre que les restrictions conformes à la loi et nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, de la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui, ne peut s’appliquer au droit d'un enfant à la liberté d'association.217
L'accès à l’information
A. Comment le droit des enfants à accéder aux informations est-il protégé par la législation nationale ? Existe-t-il des protections dans la Constitution nationale, dans la loi ou développées par la jurisprudence ?
La Loi sur l'accès à l'information accorde aux particuliers un droit général d'accès à l'information et aux archives détenues par le gouvernement.218 Cependant, cette loi omet tout droit d'accès à l'information spécifique pour les enfants.
L'article 17 de la CIDE reconnaît que les enfants ont le droit d'accéder « à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale ». L'article 17 confie à l'État la responsabilité : d’encourager la diffusion d'informations utiles sur le plan social et culturel qui soutiennent l'éducation de l'enfant ; d’encourager la production et la diffusion de livres pour enfants ; et d’élaborer des lignes directrices adaptées pour protéger les enfants des informations et du matériel susceptibles de nuire à leur bien-être.219
L'article 28 de la CIDE reconnaît le droit de l'enfant à l'éducation,220 et conformément à l'article 29(e) de la CIDE, le Canada a convenu que l'éducation des enfants doit viser, entre autres, au développement du respect de l'environnement naturel.221
Le droit à l'éducation et l'obligation de fréquenter l'école sont également reconnus au niveau provincial/territorial.222
B. Existe-t-il des limites ou des restrictions légales au droit d'accès à l’information qui s'appliquent spécifiquement aux enfants ?
Il ne semble pas y avoir de limitations expresses au droit d'accès aux informations qui s'appliquent spécifiquement aux enfants.
C. Le programme scolaire national comprend-il une éducation à l'environnement ?
L'éducation est administrée au niveau des gouvernements provinciaux et territoriaux. Cependant, des efforts similaires pour mettre en œuvre l'éducation environnementale dans les programmes scolaires peuvent être constatés dans les provinces et les territoires. Les sections ci-dessous détaillent plusieurs façons d’intégrer l'éducation environnementale dans les programmes scolaires.
Ontario
Le gouvernement de l'Ontario a élaboré un guide de ressources sur l'éducation environnementale pour le programme d'études au niveau secondaire.223
Pour les Arts, les enseignants sont encouragés à emmener les élèves hors de la salle de classe et dans l'environnement naturel, permettant aux élèves d'observer, d'explorer et d'enquêter sur la nature. Les enseignants sont encouragés à concevoir des activités qui permettent aux élèves d'intégrer des matériaux naturels dans leurs projets créatifs et à animer des performances et des installations qui se déroulent dans l'environnement naturel. Le gouvernement de l'Ontario reconnaît que les arts peuvent être un outil important pour permettre aux élèves d’exprimer l'impact social et politique des problèmes environnementaux.224
Le programme d'études commerciales identifie « la compréhension et / ou la détermination des conséquences sociales et environnementales des pratiques commerciales aux niveaux local, national et mondial », en particulier dans un contexte environnemental, comme l'un des domaines d'apprentissage fondamentaux en matière d'éducation environnementale.
En ce qui concerne les programmes d'économie, les étudiants sont encouragés à analyser l'impact environnemental de la croissance économique ainsi que les problèmes liés à la rareté des ressources naturelles. Le programme de géographie couvre des sujets environnementaux tels que la gestion des ressources, la croissance démographique, l'étalement urbain et l'impact de l'activité humaine sur l'environnement naturel, ainsi que la manière dont la gérance de l'environnement peut être améliorée. Dans les programmes d'histoire mondiale jusqu'à la fin du XVe siècle, les élèves explorent comment l'environnement a affecté la colonisation et contribué à la différenciation entre les sociétés et les régions. Pour les cours de droit, les étudiants examinent le concept de « justice » pour les espèces animales et les autres êtres vivants et ils examinent comment la législation sur les droits de la personne et la législation environnementale sont liées. De même, en droit canadien et international, les étudiants évaluent l'efficacité des lois sur la protection de l'environnement, tant au pays qu'à l'étranger.225
En politique, les étudiants apprennent que les responsabilités de la citoyenneté comprennent la protection et la gestion des biens communs mondiaux (par exemple, l'air et l'eau) à l’échelle locale, nationale et mondiale. D'autres étudiants ont la possibilité d'explorer diverses questions environnementales d'importance politique.226
Les cours d'éducation à l'orientation explorent les carrières liées à l'environnement, comment les préoccupations environnementales actuelles peuvent affecter les emplois et le marché du travail, et quelles pratiques en milieu de travail ont été adoptées pour protéger l'environnement.227
Le programme de sciences met davantage l'accent sur la technologie, la société et l'environnement afin de mettre en jeu des contextes adéquats permettant aux élèves d'appliquer ce qu'ils ont appris sur l'environnement, de réfléchir de manière critique aux problèmes environnementaux et d'envisager les mises en pratique personnelles qui peuvent être prises pour protéger l'environnement. Les enseignants ont la possibilité de faire sortir les élèves de la classe pour observer, explorer et enquêter sur la nature.228
L'éducation au changement climatique a été intégrée au programme en réponse à l'anxiété ressentie par de nombreux jeunes quant à l'état de l'environnement et aux effets du changement climatique sur les villes et les communautés. Parmi les exemples d'éducation au changement climatique et à l'environnement qui ont été mis en œuvre dans la pratique, on peut citer : dans le domaine linguistique, la recherche et la création de podcasts et l'exploration de solutions à l'injustice sociale et à l'extinction des animaux ; et dans le domaine des études environnementales, le test des niveaux de pH dans des échantillons d'eau du bassin versant local.229
Manitoba
Le ministère de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba a mis en place une Initiative de Développement Durable, un Plan d'Action pour l'Éducation au Développement Durable, et un groupe de travail sur l'Éducation au Développement Durable.230
Les enseignants sont encouragés à intégrer les concepts de développement durable dans divers domaines du programme. Les résultats d'apprentissage pour les cours des Sciences de 10e année comprennent la description des développements scientifiques et technologiques et l'appréciation de leur impact sur les individus, les sociétés et l'environnement, tant au niveau local que mondial ; et l’identification et la présentation des actions qui favorisent un environnement, une société et une économie durables, tant au niveau local que mondial.231
Dans le cours « Enjeux mondiaux : Citoyenneté et Développement durable », les étudiants appliquent des concepts liés au développement durable ; ils apprennent l'interdépendance des systèmes environnementaux, sociaux, politiques et économiques ; et ils développent des compétences pour penser et agir en tant que citoyens écologistes engagés envers la justice sociale. Le programme du cours reconnaît que l'éducation joue un rôle clé dans l'information du changement personnel et social. L'état de déclin environnemental de la planète faisait partie des raisons d’être de ce cours.232
Nouvelle-Écosse
La Nouvelle-Écosse a mis au point un assistant pédagogique pour les éducateurs afin d'encourager l'intégration de l'éducation sur les changements climatiques dans les programmes scolaires.233
Île-du-Prince-Édouard
Dans le cadre du programme d'études de la 10e à la 12e année, les Sciences de l'environnement favorisent une appréciation et une compréhension de l'environnement et du développement durable. Le programme permet un contenu de cours flexible, ce qui donne aux enseignants et aux étudiants la possibilité de sélectionner des sujets locaux ou des domaines qui les intéressent. Une partie du cours est consacrée à l'apprentissage par projet, qui engage la pensée critique, la résolution de problèmes et les compétences de prise de décision des étudiants.234
Les sujets liés à l'environnement sont également abordés dans des cours tels que les Sciences,235 Études Canadiennes,236 et Géographie.237
Alberta
Le Conseil Albertain pour l'éducation environnementale, en collaboration avec un groupe de travail composé de représentants de l'éducation et de l'industrie, a présenté une proposition visant à intégrer l'éducation environnementale et durable dans le programme d'études des provinces. La proposition a identifié des concepts environnementaux clés dans les différents domaines. Par exemple, à travers les Sciences, les élèves développent une compréhension de la façon dont les humains font partie de la nature et dépendent des écosystèmes et des interactions entre les organismes au sein des écosystèmes et entre eux.238 En Sciences Sociales, les étudiants observent les impacts économiques, sociétaux et environnementaux des prises de décision et mesures prises au niveau personnel, local, national et mondial afin de créer un avenir durable.239 En Bien-être, les expériences des élèves avec la nature développent leur bien-être émotionnel, mental, psychologique, comportemental et physique.240
En réponse aux grèves climatiques de 2019, l'Alberta Council for Environmental Education a publié des conseils pour les éducateurs par rapport à la façon d'enseigner les questions climatiques. Les propositions incluent la remise en contexte de la question climatique pour enseigner des solutions, pas seulement de problèmes, l’assistance pour les élèves à agir tant au niveau personnel que public, et l’encouragement pour les étudiants à penser au-delà d'eux-mêmes, aux générations futures et à être des citoyens du monde.241
Colombie-Britannique
Le programme d'études secondaires de la Colombie-Britannique comprend un cours sur les Ressources Durables en 11e et 12e année, qui examine les principales industries de ressources de la Colombie-Britannique telles que l'agriculture, l'énergie, les pêches, la foresterie et l'exploitation minière. La province a élaboré un programme de cours sur le développement durable avec des modules qui peuvent être utilisés individuellement ou comme un cours complet. Les modules comprennent l'éthique environnementale et le développement social, les défis environnementaux et solutions durables, et l'équilibre entre écologie et économie.242
La Colombie-Britannique a élaboré un guide du programme d'études sur l'Éducation Environnementale, pour situer les résultats attendus de l'apprentissage environnemental chez les élèves à partir de la maternelle jusqu'à la 12e année. Au niveau élémentaire, les attentes d'apprentissage comprennent la description des moyens de réduire, de réutiliser, de recycler et de démontrer un comportement responsable en prenant soin de l'environnement immédiat. Au niveau secondaire, les attentes comprennent la conception et la réalisation d'une expérience pour identifier et comparer les propriétés des produits ménagers et démontrer une prise de conscience des problèmes de santé, de sécurité, économiques et environnementaux liés à leur utilisation.243
Territoires du Nord-Ouest
Les élèves en Sciences Expérimentales sont encouragés à adopter une attitude responsable face à l'acquisition et l'application des connaissances scientifiques et technologiques pour le bénéfice mutuel de l’individu, de la société et de l'environnement. Le programme comprend des activités qui encouragent des comportements raisonnables vis-à-vis du vivant et de l'environnement. De plus, des connaissances autochtones traditionnelles locales sont intégrées au cours. Les étudiants sont encouragés à "connaître" le terrain, à être observateurs et à assurer un environnement de travail sûr pour tous.244
Les élèves en Sciences Sociales ont la possibilité de démontrer leur conscience des limites de l'environnement naturel, de l'intendance de la terre et d'une compréhension des principes de durabilité.245
Pour les Études Nordiques, la gérance de l'environnement est identifiée comme l'un des principes directeurs parmi les communautés des Premières Nations.246
***
End notes
1 Charte canadienne des droits et libertés, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-12.html.
2 Ibid, article 1.
3 Bien que la Charte accorde des droits à toutes les personnes au Canada, certains droits sont limités aux citoyens canadiens, par exemple, le droit de vote en vertu de l’article 3.
4 La Charte ne protège pas explicitement les droits des enfants, mais les droits des enfants ont été reconnus par la jurisprudence relative à la Charte. Par exemple, le principe de Jordan garantit que tous les enfants des Premières nations vivant au Canada peuvent accéder aux produits, services et soutiens dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. De plus amples informations sur le “principe de Jordan” et sur la manière de soumettre une demande en vertu de ce principe sont disponibles sur : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1568396042341/1568396159824. Voir aussi « Statut juridique des droits de l’enfant au Canada » (L’Association du Barreau Canadien) https://www.cba.org/Publications-Resources/Practice-Tools/Child-Rights-Toolkit/overarchingFramework/Legal-Status-of-Child-Rights-in-Canada?lang=fr-ca et Préambule de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/y-1.5/TexteComplet.html.
5 Lynda M. Collins, Safeguarding the Longue Durée : Environmental Rights in the Canadian Constitution, (2015) 71 Supreme Court Law Review 519, (2015) CanLIIDocs 5180, disponible en anglais sur : http://www.canlii.org/t/ss8k.
6 Ibid.
7 Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] SCJ n° 33, [2005] 1 RCS 791 (CSC) disponible sur : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2237/index.do.
8 Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] SCJ No. 95, [1997] 3 RCS 844, [66]-[68] (CSC) disponible sur : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1560/index.do.
9 Québec (Procureur général) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, [2018] CSC 17 (CanLII) https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17077/index.do; Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureur général), [2018] CSC 18 (CanLII) https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17078/index.do.
10 Fondation canadienne pour l’enfance, la jeunesse et le droit c. Canada (Procureur général), [2004] RCS 76, [53] https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2004/2004csc4/2004csc4.html; Gosselin c. Québec (Procureur général) [2002] CSC 84, [2002] 4 RCS 429, https://canlii.ca/t/1g2w1; Wynberg c. Ontario [2006] CanLII 22919 (ON CA), disponible en anglais sur https://canlii.ca/t/1nwd6.
11 Alinéa 10(1), Code des droits de la personne de l’Ontario : l’âge est défini comme «un âge de 18 ans ou plus ». A noter : il existe une petite exception pour les 16 et 17 ans dans le cadre du logement locatif.
12 Arzem c Ontario (Services sociaux et communautaires), [2006] TDPO 17 (CanLII), https://www.canlii.org/fr/on/legis/regl/rro-1990-regl-737/7918/rro-1990-regl-737.html.
13 Pour une discussion supplémentaire sur les droits environnementaux dans le contexte de la constitution, voir : Lynda M. Collins, An Ecologically Literate Reading of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, (2009), Windsor Review of Legal and Social Issues Vol. 26; Lynda M. Collins, Security of the person, peace of mind: a precautionary approach to environmental uncertainty, (2013), Journal of Human Rights and the Environment, Vol. 4, No.1, 79-100; Lynda M. Collins & Meghan Murtha, Indigenous Environmental Rights in Canada: The Right to Conservation Implicit in Treaty and Aboriginal Rights to Hunt, Fish, and Trap, (2010), Indigenous Environmental Rights in Canada, Vol.47, No.4, 959-992.
14 Supra 5. Reference re Secession of Quebec, [1998] SCJ No. 61, [1998] 2 RCS 217, [49]-[52] (S.C.C.), tel que cité dans Collins, Id., à la page 534.
15 R c. Hydro-Québec [1997] 3 RCS 213, 124, https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1542/index.do.
16 Ontario c. Canadien Pacifique Ltée. [1995] S.C.J. n° 62, [1995] 2 RCS. 1031 (CSC) : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1280/index.do.
17 Ibid.
18 Maracle, Lee. L’opération a réussi, mais le patient est décédé, Walkem, Ardith et Halie Bruce, éd. Boîte aux trésors ou boîte vide ? Vingt ans de l’Alinéa 35. Vancouver : Theytus, (2003). 309-315 (en anglais).
19 Tsawout Indian Band v. Saanichton Marina Ltd., [1989] B.C.J. No. 563, 57 D.L.R. (4th) 161 (B.C.C.A.). Halfway River First Nation c. British Columbia (Ministère des Forêts), [1997] B.C.J. No. 1494, 39 B.C.L.R. (3d) 227 (B.C.S.C.) [ci-après “Halfway”]. Mikisew Cree First Nation c. Canada (Ministre du Patrimoine Canadien), [2001] ACF n° 1877, 214 FTR 48 (FCTD).
20 Mikisew Cree First Nation c. Canada (Gouverneur général en conseil) [2018] CSC 40, 2 RCS 765 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scccsc/fr/item/17288/index.do.
21 ÉcoJustice Canada, Defending the Rights of Chemical Valley Residents Charter Challenge, Lockridge and Plain v. Director, Minister of Environment et al. disponible en anglais sur: https://www.ecojustice.ca/case/defending-the-rights-of-chemical-valley-residents-charter-challenge/.
22 Grassy Narrows v. Ontario, Ontario Superior Court of Justice Court File No. 446/15, disponible en ligne (en anglais) : https://cela.ca/wp-content/uploads/2019/07/factum_complete.pdf.
23 Amnesty International, Environnement Jeunesse (ENJEU) v. Attorney General of Canada: Legal Briefing, (26 Février 2020), disponible en anglais sur: https://www.amnesty.ca/legal-brief/environnement-jeunesse-enjeu-v-attorney-general-canada/.
24 Environnement Jeunesse (ENJEU) v. Attorney General of Canada, No. 500-06-000955-183, [127] et [136]: Decision dated 11th July 2019, http://climatecasechart.com/non-us-case/environnement-jeunesse-v-canadian-government/.
25 Environmental Law Centre, Climate Change Litigation in Canada: Environnement Jeunesse v. Canada, disponible en anglais sur: https://elc.ab.ca/climate-change-litigation-in-canada-environnement-jeunesse-v-canada/.
26 Climate Case Chart, Environnement Jeunesse (ENJEU) v. Attorney General of Canada, http://climatecasechart.com/non-us-case/environnement-jeunesse-v-canadian-government/.
27 Ecojustice, Mathur et. al. v. Her Majesty in Right of Ontario, Overview of Notice of Application, disponible en anglais sur: https://www.ecojustice.ca/wp-content/uploads/2019/11/Overview-of-Notice-of-Application.pdf.
28 Tableau de cas climatique, Mathur, et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario, disponible en anglais sur: http://climatecasechart.com/non-us-case/mathur-et-al-v-her-majesty-the-queen-in-right-of-ontario/.
29 La Rose v. The Queen, [2020] CF 1008, https://climatecasechart.com/non-us-case/la-rose-v-her-majesty-the-queen/.
30 Tableau de cas climatique, La Rose v. Her Majesty the Queen, disponible en anglais sur: http://climatecasechart.com/non-us-case/la-rose-v-her-majesty-the-queen/.
31 Misdzi Yikh. c. Canada [2020] CF 1059 (CanLII), https://www.canlii.org/fr/ca/fct/doc/2020/2020fc1059/2020fc1059.html.
32 Ibid. [77]
33 Climate Case Chart, Lho’imggin et al. v. Her Majesty the Queen, disponible en anglais sur: http://climatecasechart.com/non-us-case/gagnon-et-al-v-her-majesty-the-queen/.
34 The Law Review, Environment and Climate Change Law Review: Canada, (2020), disponible en anglais sur: https://thelawreviews.co.uk/edition/the-environment-and-climate-change-law-review-edition-4/1215612/canada.
35 Lynda M. Collins, Safeguarding the Longue Durée: Environmental Rights in the Canadian Constitution, (2015) 71 Supreme Court Law Review 519, (2015) CanLIIDocs 5180, disponible en anglais sur: http://www.canlii.org/t/ss8k.
36 The Law Review, Environment and Climate Change Law Review: Canada, (2020), disponible en anglais sur: https://thelawreviews.co.uk/edition/the-environment-and-climate-change-law-review-edition-4/1215612/canada#footnote-078.
37 R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] SCJ n° 23, [1988] 1 RCS 401 (CSC); R. c. Hydro-Québec, [1997] SCJ n° 76, [1997] 3 RCS 213 (CSC).
38 Ontario c. Canadien Pacifique Ltée. [1995] SCJ n° 62, [1995] 2 RCS 1031 (CSC), https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1280/index.do.
39 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] SCJ n° 42, [2001] 2 RCS 241 (CSC). https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1878/index.do.
40 Lynda M. Collins, Safeguarding the Longue Durée: Environmental Rights in the Canadian Constitution, (2015) 71 Supreme Court Law Review 519, (2015) CanLIIDocs 5180, disponible en anglais sur: http://www.canlii.org/t/ss8k.
41 Practical Law, Environmental Law and Practice: Canada Overview, disponible en anglais sur: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-503-2764.
42 Ibid.
43 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, L’Accord de Paris, (22 novembre 2017), en ligne : https://unfccc.int/fr/a-propos-des-ndcs/l-accord-de-paris.
44 Climate and Clean Air Coalition, Short-Lived Climate Pollutants (SLCPs), https://www.ccacoalition.org/fr/content/short-lived-climate-pollutants-slcps.
45 Environnement et Changement climatique Canada, Participation à des accords internationaux en matière d’environnement: https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/affaires-internationales/partenariats-organisations/participation-accords-internationaux-environnement.html.
46 North Western Territories, Environmental Rights Act (2019), https://www.canlii.org/fr/nt/legis/lois/ltn-o-2019-c-19/derniere/ltn-o-2019-c-19.html.
47 Nunavut, Environmental Protection Act (1988), https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/policies-legislations/2022-01/rsnwt-nu-1988-c-e-7-part-1.pdf.
48 Yukon, Loi sur l’environnement (2002), http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/environment_c.pdf.
49 Parlement du Canada, Projet de Loi C-438, https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-438/premiere-lecture.
50 Parlement du Canada, Projet de Loi C-438, Info législation, https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/42-1/c-438.
51 Gouvernement du Canada, Le gouvernement du Canada respecte son engagement de renforcer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et reconnaît le droit à un environnement sain (2022), https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2022/02/; https://ecojustice.ca/senate-proposed-sweeping-changes-to-cepa/ et https://cela.ca/law-reform-reforming-the-canadian-environmental-protection-act/.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, https://nben.ca/fr/charte-des-droits.html.
56 Le GTNO adopte un énoncé de valeurs environnementales, (2022), https://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/gnwt-adopts-statement-environmental-values.
57 Blakes, Blakes 26th Annual Overview of Environmental Law and Regulation in British Columbia (2021), disponible en anglais sur: https://www.blakes.com/getmedia/234e0eaa-976f-494d-8e71-811d65a45de8/Blakes_Overview_of_Environmental_Law_of_BC_2021.pdf.aspx.
58 Government of British Columbia, Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, disponible en anglais sur: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/indigenous-people/new-relationship/united-nations-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.
59 Coastal GasLink Pipeline Ltd. c. Huson [2019] BCSC 2264, disponible en anglais sur: https://www.coastalgaslink.com/siteassets/pdfs/whats-new/2019/2019-12-31-coastal-gaslink-comments-on-injunction-decision/judge-church--coastal-gaslink-pipeline-ltd.-v.-huson--december-2019.pdf.
60 BC Hydrogen Office, disponible en anglais sur: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/renewable-energy/hydrogen-office.
61 D. 871-2020, Loi sur la qualité de l’environnement, (chapitre Q-2), Gazette Officielle Du Québec, (2 septembre 2020), Vol. 152, n° 36A, disponible en anglais sur: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=13&file=2036A-A.PDF.
62 Canadian Environmental Law Association, disponible en anglais sur: https://cela.ca/law-reform-ontarios-environmental-bill-of-rights/.
63 Règl. de l’Ont. 79/15: Alternative Low-Carbon Fuels, disponible en anglais sur: https://www.ontario.ca/laws/regulation/150079.
64 Supra 51.
65 John Tidball, Aaron Atcheson, Bryan Buttgieg, Tamara Farber, Luc Gratton and Sarah Hansen, Environmental law and practice in Canada: overview, Thomson Reuters Practical Law (2009), disponible en anglais sur: https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/2-503-2764.
66 Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre 2021 CSC 11, https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2021/2021csc11/2021csc11.html.
67 Chambers and Partners, Environmental Law Canada, (2021), https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/environmental-law-2023/canada.
68 Rebeca Kauffman, The Canadian Constitution, the Environment, and the Misguided Notions of Provincial Sovereignty, Environmental Law Centre (2022), disponible en anglais sur: https://elc.ab.ca/the-canadian-constitution-the-environment-and-the-misguided-notions-of-provincial-sovereignty/.
69 Ibid.
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 R c. Hydro-Québec [1997] 3 RCS 213, 124, https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/1542/index.do.
75 Kathleen Cooper, Toxic Substances - Focus on Children. Developing a Canadian List of Substances of Concern to Children’s Health, Canadian Environmental Law Association and Pollution Probe (2004), disponible en anglais sur: https://cela.ca/wp-content/uploads/2019/06/List_Project_Full_Report.pdf.
76 Gouvernement du Canada, Liste des substances toxiques gérées sous la Loi canadienne sur la protection del’environnement (2022), https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-substances-toxiques/liste-loi-canadienne-protection-environnement.html.
77 Gouvernement du Canada, Inventaire national des rejets de polluants, (2022), https://www.canada.ca/fr/services/environnement/pollution-gestion-dechets/inventaire-national-rejets-polluants.html.
78 Canlii Connects, Forum Non Conveniens, In a Nutshell, https://canliiconnects.org/en/commentaires/36183.
79 Voir, par exemple, Martin Olszynski, Environmental Laws as Decision-Making Processes (or, Why I am Grateful for Environmental Groups this Earth Day), 22 avril 2015, disponible en anglais sur: https://ablawg.ca/wp-content/uploads/2015/04/Blog_MO_EarthDay_April2015.pdf.
80 Gouvernement du Canada, À propos de la Loi sur l’application des lois environnementales (2021), https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/lois-reglements/a-propos-loi.html; voir aussi William Amos, John Lammey, Meredith Cairns et Ceyda Turan, Getting Tough on Environmental Crime ? Holding the Government of Canada to Account on Environmental Enforcement, Ecojustice (2011), disponible en anglais sur: https://www.ecojustice.ca/wp-content/uploads/2014/08/Getting-Tough-on-Environmental-Crime.pdf.
81 Bennett Jones, A Summary of Canadian Environmental Law for Non-Canadian Practitioners, (2013), https://www.bennettjones.com/Publications-Section/Updates/A-Summary-of-Canadian-Environmental-Law-for-Non-Canadian-Practitioners.
82 Par exemple, en vertu de la loi albertaine sur la protection et l’amélioration de l’environnement, RSA (2000), c E-12, l’article 234(1) autorise également la « peine créative » par les tribunaux, ce qui inclut, en plus de toute sanction, la possibilité de déposer des cautions, ordonner la publication des faits, ordonner les actions nécessaires pour réparer ou prévenir un préjudice supplémentaire, exécution de travaux d’intérêt général. Shaun Fluker, Let’s Shine Some Light into Creative Environmental Sentencing, (21 Juin 2017), en ligne: ABlawg, https://ablawg.ca/wp-content/uploads/2017/06/Blog_SCF_CN.pdf. See also Chilenye Nwapi, Environmental Sentencing Policy in Alberta: A Critical Review, (Janvier 2015), disponible en anglais sur: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2609010.
83 Loi sur l’environnement du Yukon LRY (2002), c.76 article .8.
84 Ibid.
85 Ibid. article. 40.
86 Loi sur les droits environnementaux des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, LRTN-O. 1988, c 83 (Supp), article.5 & 6
87 Supra 51.
88 Supra 51.
89 David R. Boyd, Unnatural Law: Rethinking Canadian Environmental Law and Policy, The University of Chicago Press, (2011) à la p.247.
90 Ibid.
91 Ibid.
92 Par exemple, voir Hollick c. Toronto (Ville), [2001] CSC 68 (CanLII), [2001] 3 RCS 158, où la Cour suprême du Canada a conclu que 30 000 demandeurs sollicitant une accréditation, en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario, qui se plaignaient du bruit et de la pollution physique provenant d’une décharge détenue et exploitée par la ville répondante, n’ont pas été en mesure de démontrer la preuve requise. « L’appelant n’a pas établi que le recours collectif est le meilleur moyen de régler les demandes en l’espèce. En ce qui concerne l’économie de ressources judiciaires, toute question commune en l’espèce est négligeable par rapport aux questions individuelles. Même si chaque membre du groupe doit, pour obtenir réparation, prouver la pollution physique ou sonore, il est probable que certains secteurs ont été touchés plus gravement que d’autres et que différentes parties du territoire ont été frappées à différents moments. Une fois la question commune considérée dans le contexte global de la demande, il devient difficile d’affirmer que le règlement de la question commune fera progresser substantiellement l’instance. Autoriser le recours collectif en l’espèce ne favoriserait pas non plus l’accès à la justice.» (par. 30-32). https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/1908/index.do.
93 Smith c. Inco Ltée. Smith c. Inco Limitée, [2011] ONCA 628 (CanLII), disponible en anglais sur: https://www.siskinds.com/wp-content/uploads/2011ONCA0628.pdf.
94 Ibid. paragraphe 35.
95 Ernst c. Alberta (Energy Resources Conservation Board), [2014] ABCA 285, disponible en anglais sur: https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2014/2014abca285/2014abca285.html.
96 Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta [2007] CSC 22, [2007] 2 RCS 3 (31 mai 2007). https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2362/index.do
97 Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd, [2015] CSC 53 (CanLII), disponible en anglais sur: https://www.canlii.org/fr/ca/scc/doc/2015/2015scc53/2015scc53.html.
98 Coastal First Nations c. Colombie-Britannique (Environnement), [2016] BCSC 34 aux paragraphes. 55-56, disponible en anglais sur: https://www.bccourts.ca/jdb-txt/sc/16/00/2016BCSC0034cor1.htm.
99 Renvoi relatif à l’Environmental Management Act (Colombie-Britannique), [2019] BCCA 181.
100 Pour plus d’informations, voir Lynda M Collins et Meghan Murtha, Indigenous Environmental Rights in Canada: The Right to Conservation Implicit in Treaty and Aboriginal Rights to Hunt, Fish, and Trap, (2010) CanLIIDocs 297, disponible en anglais sur: https://canlii.ca/t/2cxs.
101 Friends of the Earth v. The Governor in Council and Others, [2008] FC 1183; [2009] FCA 297, disponible en anglais sur: http://climatecasechart.com/non-us-case/friends-of-the-earth-v-the-governor-in-council-et-al/.
102 Pour plus d’informations sur la doctrine de la justiciabilité dans les affaires environnementales voir : https://www.cba.org/Sections/Public-Sector-Lawyers/Resources/Resources/2021/PSLEssayWinner2021.
103 Kelly c. Alberta (Energy Resources Conservation Board), [2009] ABCA 349 (CanLII).
104 Kelly v. Alberta (Energy and Utilities Board), [2008] ABCA 52 (CanLII), disponible en anglais sur: https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2008/2008abca52/2008abca52.html.
105 Ibid, paragraphe 12.
106 Zoocheck Canada Inc c Alberta (Ministre de l’Agriculture et des Forêts), [2019] ABCA 208, disponible en anglais sur: https://www.zoocheck.com/wp-content/uploads/2019/05/Court-of-Appeal-Decision-Lucy-2019.pdf où la Cour d’appel de l’Alberta a refusé la qualité pour agir à une ONG cherchant à contester la légalité du confinement de Lucy, l’éléphant au zoo d’Edmonton, en contestant le permis du zoo; comparer avec Free Roaming Horses Society de l’Alberta contre l’Alberta, [2019] ABQB 714 https://www.canlii.org/en/ab/abqb/doc/2019/2019abqb714/2019abqb714.html où la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a accordé qualité pour agir à une ONG cherchant à plaider au nom du cheval sauvage en contestant une désignation foncière.
107 Shiell c.Amok Ltd. [1987], 1987 CanLII 4563 (SK QB) (le tribunal a refusé au demandeur la qualité pour agir dans l’intérêt public lorsque la loi prévoyait sa propre application) ; voir également Cassells c. Université de Victoria, [2010] BCSC 1213, où la Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé la qualité pour agir à un simple citoyen alléguant que l’Université de Victoria violait les lois environnementales parce que le citoyen ne contestait pas les actions du gouvernement.
108 Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences [2022] CSC 27, https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/19424/index.do.
109 Council of Canadians with Disabilities v. British Columbia (Attorney General), [2020] BCCA 241, https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2020/2020bcca241/2020bcca241.html.
110 Ibid.
111 Ibid.
112 Joey Jang, British Columbia v Council of Canadians with Disabilities: Deciding Public Interest Standing, The Court (2022), disponible en anglais sur: http://www.thecourt.ca/british-columbia-v-council-of-canadians-with-disabilities-deciding-public-interest-standing/.
113 Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences [2022] CSC 27, https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/19424/index.do.
114 Supra 113.
115 Toutes les juridictions canadiennes peuvent accepter les recours collectifs à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans Western Canadian Shopping Centre Inc. c Dutton, [2001] 2 RCS 534 (Dutton) https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1884/index.do, qui a autorisé les recours collectifs dans toutes les juridictions canadiennes. La plupart des provinces ont des lois provinciales sur les recours collectifs (ou, dans le cas du Québec, des dispositions sur les recours collectifs dans son Code de procédure civile), et celles qui n’en ont pas peuvent invoquer la décision de Dutton. Le système judiciaire fédéral a des procédures de recours collectif inscrites dans ses règles de procédure. Voir, par exemple, BLG, A Summary of Canadian Class Action Procedure and Developments, (Septembre, 2018).
116 Environmental Law Centre, Standing in Environmental Matters, (December 2014), disponible en anglais sur: https://elc.ab.ca/media/98894/Report-on-standing-Final.pdf au 36.
117 Gouvernement du Canada, Représentation juridique des enfants au Canada, https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/rje-lrc/p2.html.
118 Alberta Rules of Court, Alta Reg 124/2010, Section 2.11 (a), https://www.canlii.org/en/ab/laws/regu/alta-reg-124-2010/#sec2.11_smooth.
119 Ibid, paragraphe 12.6(1).
120 Ibid, paragraphe 12.6(2).
121 Debra Lovinsky and Jessica Gagne, Legal Representation of Children in Canada, The Family, Children and Youth Section Department of Justice Canada (2015) at 37, disponible en anglais sur: https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/lrc-rje/lrc-rje.pdf.
122 Règles civiles de la Cour suprême, disponible en anglais sur: https://canlii.ca/t/55lxj.
123 Loi sur le droit de la famille, SBC 2011, ch. 25, article 201, disponible en anglais sur: https://canlii.ca/t/55k2w.
124 Manitoba Association for Rights & Liberties and The Manitoba Law Foundation, The Under 18 Handbook, https://marl.mb.ca/wp-content/uploads/2023/02/MARL_UNDER-18-HANDBOOK.pdf.
125 Done.Bureau de l’avocat des enfants, ministère du Procureur général de l’Ontario, Mise à jour annuelle 2014-2015. (Juillet 2015), ch.3. http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/ocl_annual/BAE_annual_report_2015.html [consulté en octobre 2022].
126 Défenseur du Manitoba, disponible en anglais sur: https://manitobaadvocate.ca/adult/what-we-do/.
127 Règles de la Cour du Nouveau-Brunswick, Règl. 82-73, règle 7.01(a).
128 Ibid, règle 7.02(1).
129 Ibid, règle 7.03(1).
130 Ibid, règles 7.04(2) et 7.04(3).
131 Règles de la Cour suprême, (1986) SNL (1986), c 42 Sch D, règle 8.01(1) et règle 8.01(3), https://www.canlii.org/en/nl/laws/regu/snl-1986-c-42-sch-d/latest/snl-1986-c-42-sch-d.html.
132 Ibid, règle 8.02(1).
133 Done.Règles de la Cour Suprême des Territoires du Nord-Ouest, NWT Reg 101-96, règle 7(1).
134 Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, L’aide juridique, https://www.justice.gov.nt.ca/fr/aide-juridique/.
135 Nova Scotia Civil Procedure Rules, Rule 34.02(a), disponible en anglais sur : https://courts.ns.ca/operations/rules/civil-procedure-rules.
136 Rules of Court of Nunavut, R-010-96, Rule 79(1) and 79(2), disponible en anglais sur : https://www.nunavutcourts.ca/court-policies/rules.
137 Bureau de l’avocat des enfants, https://www.ontario.ca/fr/page/bureau-de-lavocat-des-enfants.
138 Ibid.
139 Rules of Civil Procedure of Prince Edward Island, Rule 7.01(1), disponible en anglais sur: https://www.courts.pe.ca/sites/www.courts.pe.ca/files/Forms%20and%20Rules/A-7.pdf.
140 Ibid, règle 7.03(1).
141 Ibid, règle 7.04(1).
142 Code de procédure civile du Québec 2014, c. 1, un. 87 ; I.N. 2016-12-01. Disponible sur : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/cs/c-25.01.
143 Ibid, a. 90.
144 Queen’s Bench Rules, Rule 2-14(1), https://publications.saskatchewan.ca/#/products/33483.
145 Ibid, Règle 2-14(3).
146 Ibid, règle 2-15(1).
147 Supreme Court Rules of Yukon, Rule 6(2) et 6(4), disponible en anglais sur: https://www.yukoncourts.ca/sites/default/files/2022-10/2022%20Rule%206%20PERSONS%20UNDER%20DISABILITY.pdf.
148 Ibid, règle 6(5).
149 Snell c. Farrell, [1990] 2 RCS 311, 323–30 (Can.); F.H. c. McDougall, 2008 SCC 53; Allan E. Ingleson (Ed.), Environment in the courtroom, University of Calgary Press, (2019), disponible en anglais sur: https://prism.ucalgary.ca/bitstream/handle/1880/109483/9781552389867_chapter14.pdf?séquence=16&isAllowed=y. Pour une discussion approfondie, voir Lynda M. Collins, Material Contribution to Risk in the Canadian Law of Toxic Torts, 2 Chicago-Kent Law Review 91, 567, (16 mai 2016).
150 West Coast Environmental Law, EDRF Legal Aid Fund, https://www.wcel.org/program/edrf-legal-aid-fund.
151 Pacific Center for Environmental Law and Litigation, https://www.pacificcell.ca/.
152 Ecojustice, https://ecojustice.ca/.
153 East Coast Environmental Law, https://www.ecelaw.ca/.
154 Claude Martine, Interlocutory injunctions and the Environment: Comparing the Law Between Quebec and Other Provinces, (2004) 13 J Env. L & Prac. 359.
155 Code de procédure civile, art 55, art 59, en anglais: https://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/cqlr-c-c-25.01/latest/cqlr-c-c-25.01.html#document.
156 Ibid, art 752.
157 Supra 74.
158 Paul Muldoon, Richard D. Lundgren, The Hydro-Quebec Decision: Loud Hurray or Last Hurrah?, (1997) Canadian Environmental Law Association, Law Times.
159 Reference re Greenhouse Gas Pollution Pricing Act [2019] SKCA 40 (CanLII). Disponible en anglais sur : https://canlii.ca/t/j03gt.
160 Reference re Greenhouse Gas Pollution Pricing Act [2021] SCC 11. Disponible sur : https://canlii.ca/t/jdwnw.
161 Saskatchewan v. Canada re Greenhouse Gas Pollution Pricing Act; Projet de Loi C-74, Section 5 [2019] SKCA 40. Disponible en anglais sur: http://climatecasechart.com/non-us-case/saskatchewan-v-canada-re-greenhouse-gas-pollution-pricing-act-bill-c-74-part-5/.
162 Canada Act 1982, s 52(1), disponible en anglais sur: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11.
163 Charte canadienne des droits et libertés, p24(1) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html.
164 R c Demers [2004] 2 RCS 489 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2160/index.do.
165 Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, (2019) Thomson Reuters 5.
166 R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 RCS 575 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1922/index.do.
167 Ministère de la Justice, Section 24(1) Charterpedia (17 juin 2019). https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art241.html.
168 Ibid.
169 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 RCS 3 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2096/index.do?alternatelocale=fr.
170 Supra 80.
171 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-15.31/.
172 Ministère de la Justice Canada, Guide explicatif la Loi canadienne sur la protection de l’environnement: chapitre 14, (4 juillet 2019). https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/guide-explicatif/chapitre-14.html.
173 Renvoi relatif à l’Environmental Management Act, [2020] CSC 1. https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2020/2020csc1/2020csc1.html.
174 Association canadienne des sacs en plastique c. Victoria (Ville), [2019] BCCA 254, disponible en anglais sur : https://www.bccourts.ca/jdb-txt/ca/19/02/2019BCCA0254.htm.
175 Damstra, Jacob R. W., Supreme Court of Canada Silent on Environmental Regulation Cases, Lerners Lawyers, (5 Février 2020), disponible en anglais sur : https://www.lerners.ca/lernx/climate-cases/.
176 Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, [2019] ONCA 544. Disponible en anglais sur : https://www.ontariocourts.ca/decisions/2019/2019ONCA0544.htm.
177 Gouvernement du Canada, Registre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, (16 mai 2019). https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection.html.
178 Gouvernement du Canada, Coordonnées d’Environnement et Changement climatique Canada, (19 juillet 2019). https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/coordonnees.html.
179 Gouvernement du Québec, Environmental Complaint Procedure, Environnement et Lutte contre les changements climatique Québec (2020). Disponible en anglais sur : http://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/plaintes/env-complaint.htm.
180 Alberta Government, Energy and Environmental Response Line, (2020). Disponible en anglais sur : https://www.alberta.ca/energy-and-environmental-response-line.aspx.
181 British Columbia Government, Complaints and Inquiries, (8 Janvier 2016). https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/water/water-quality/drinking-water-quality/complaints-inquiries.
182 British Columbia Government, Report All Poachers and Polluters (RAPP), (8 Janvier 2016). https://forms.gov.bc.ca/environment/rapp/.
183 Gouvernement du Canada, Examen de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, » (29 novembre 2018). https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/examen.html.
184 Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général) [2015] 1 RCS 3 [48] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14577/index.do.
185 « Certaines écoles et collèges canadiens déménagent pour s’adapter aux grèves climatiques » CTV News (Paola Loriggio, The Canadian Press, 18 Septembre 2019). Disponible en anglais sur : https://www.ctvnews.ca/canada/some-canadian-schools-colleges-move-to-accommodate-climate-strikes-1.4599457.
186 Charte canadienne des droits et libertés, s 2(b) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html.
187 Voir Irwin Toy Ltd c Québec (Procureur général) [1989] 1 RCS 927, 976 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/443/index.do.
188 Ibid, 969 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/443/index.do; Libman c Québec (Procureur général) [1997] 3 RCS 569, [31] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1551/index.do.
189 Weisfeld c. Canada [1994] CanLII 9276 (CAF). Disponible en anglais sur : http://canlii.ca/t/2d6cp.
190 Ibid.
191 R c. Guignard [2002] 1 RCS 472 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1951/index.do.
192 Allsco Building Products Ltd c. TUAC, section locale 1288P [1999] 2 RCS 1136 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1723/index.do; TUAC, section locale 1518 contre Kmart Canada Ltd [1999] 2 RCS 1083 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1722/index.do.
193 Ramsden c. Peterborough (Ville) [1993] 2 RCS 1084 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1038/index.do.
194 Montréal (Ville) c 2952-1366 Québec Inc. [2005] 3 RCS 141 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2243/index.do.
195 Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général) [2011] 1 RCS 19, [38] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7914/index.do.
196 Convention internationale relative aux droits de l’enfant, art. 13 https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child. Bien que la CRC ne soit pas directement incorporée au droit national canadien au moyen d’une loi d’habilitation, elle est expressément mentionnée dans la législation (voir par ex. le préambule de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents), et le Canada maintient la position selon laquelle ses lois, politiques et pratiques sont conformes à la CIDE. Voir l’Introduction’ (L’Association du Barreau Canadien) http://www.cba.org/Publications-Resources/Practice-Tools/Child-Rights-Toolkit/overarchingFramework/Introduction.
197 Déclaration canadienne des droits, s 1(d) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-12.3/page-1.html.
198 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 19(2) https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights.
199 American Declaration of the Rights and Duties of Man, art iv. Disponible en anglais sur : https://www.oas.org/dil/access_to_information_human_right_American_Declaration_of_the_Rights_and_Duties_of_Man.pdf.
200 L’Association du Barreau Canadien, Statut juridique des droits de l’enfant au Canada. Disponible: http://www.cba.org/Publications-Resources/Practice-Tools/Child-Rights-Toolkit/overarchingFramework/Legal-Status-of-Child-Rights-in-Canada et Préambule de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/y-1.5/TexteComplet.html.
201 Charte canadienne des droits et libertés, s 2(b) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html.
202 Convention internationale relative aux droits de l’enfant, art. 13 https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child.
203 Charte canadienne des droits et libertés, s 2(b) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html.
204 Convention internationale relative aux droits de l’enfant, art. 15 https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child.
205 Voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art 22 https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights; American Declaration of the Rights and Duties of Man, art 22, disponible en anglais sur: https://www.oas.org/dil/access_to_information_human_right_American_Declaration_of_the_Rights_and_Duties_of_Man.pdf.
206 Voir ‘Alinéa 2(d) – Liberté d’association’, Charterpédia (Département de la Justice, 17 juin 2019) https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art2d.html.
207 Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général) [2015] 1 RCS 3 [51] - [54], [66] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14577/index.do.
208 Kate Scallion, Freedom of Association and Indigenous Governance, (2019) 40 WRKSI 113, [114].
209 Supra 207, [54], [66] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14577/index.do.
210 Lavigne contre Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario [1991] 2 RCS 211, [253] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/774/index.do?alternatelocale=fr.
211 Supra 207, [58] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14577/index.do.
212 Dunmore c Ontario (Procureur général) [2001] 3 RCS 1016 [17] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1936/index.do?alternatelocale=fr.
213 Supra 208 [117].
214 Supra 207, [52] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14577/index.do.
215 Ibid, [59].
216 Supra 208, [120].
217 Convention internationale relative aux droits de l’enfant, art. 15 https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child.
218 Loi sur l’accès à l’information https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/page-1.html.
219 Convention internationale relative aux droits de l’enfant, art. 17 https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child.
220 Ibid, art 28.
221 Ibid, art 29(e).
222 Voir, par exemple, la Loi sur les écoles publiques du Manitoba et la Loi sur l’éducation de l’Ontario.
223 Guide de ressources pour l’éducation environnementale, Programme d’études de l’Ontario de la 9e à la 12e année, [2017], https://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/environmental_ed_9to12_fre.pdf.
224 Ibid, 5.
225 Ibid, 35.
226 Ibid, 35.
227 Ibid, 111.
228 Ibid, 141.
229 David Israelson, Climate change compels schools to improve environmental literacy, The Globe and Mail, (15 octobre 2019). Disponible en anglais sur : https://www.theglobeandmail.com/featured-reports/article-climate-crisis-compels-schools-to-improve-environmental-literacy/.
230 Canadian Environmental Grantmakers’ Network, Environmental Education in Canada, (Octobre 2006), [3] https://environmentfunders.ca/wp-content/uploads/2013/10/EEBrief_Eng.pdf [consulté en octobre 2022].
231 Manitoba Curriculum Framework of Outcomes, Senior 2 Science, Annexe : General Learning Outcomes, [4.3] Disponible en anglais sur : https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/science/outcomes/s2/appendix.pdf.
232 Manitoba, Grade 12 Global Issues : Citizenship and Sustainability, Introduction, [3-4]. Disponible en anglais sur : https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/global_issues/introduction.pdf.
233 Taking on Climate Change, A teaching companion for educators in Nova Scotia, (Mars, 2013). Disponible en anglais sur : https://www.novascotia.ca/nse/climate-change/docs/AppendixC_ClimateChange_TeachingCompanion.pdf.
234 Prince Edward Island, Science Curriculum, Environmental Science, [3]. Disponible en anglais sur : https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/eelc_env621a.pdf.
235 Prince Edward Island, Science Curriculum, Science 431A, [18]. Disponible en anglais sur : https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/eelc_sci431a.pdf.
236 Prince Edward Island, Canadian Studies Curriculum, [4-7]. Disponible en anglais sur : https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/eelc_cas401a.pdf.
237 Prince Edward Island, Social Studies Curriculum, Geography 521 A, see e.g. 18. Disponible en anglais sur : https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/eelc_geo521a.pdf.
238 Excerpt from Curriculum for a Sustainable Future (as revised, January 2020), [5] https://www.abcee.org/sites/default/files/Curriculum_Sustainable_Future_SLOs_Jan_2020.pdf [consulté en octobre 2022].
239 Ibid, 9.
240 Ibid, 12.
241 Alberta Council for Environmental Education, After the climate strike! See what we’ve got for teachers… https://www.abcee.org/after-climate-strike-see-what-weve-got-teachers [consulté en octobre 2022].
242 British Columbia Ministry of Education, Sustainability Course Content: A Curriculum Framework, https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/teach/teaching-tools/environmental-learning/sustcoursecontent-1.pdf.
243 British Columbia Ministry of Education, The Environmental Learning & Experience Curriculum Maps, (2008/2009), [13 and 44] https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/teach/teaching-tools/environmental-learning/ele_maps.pdf.
244 Northwest Territories Department of Education, Culture and Employment, Experiential Science, (2006), [8-9] https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/experimental_science_10_-_30.pdf.
245 Northwest Territories Department of Education, Culture, and Employment, Social Studies Kindergarten to Grade 12, (2005), [2] https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/program-of-study-grade-10ab.pdf.
246 Northwest Territories Department of Education, Culture and Employment, Northern Studies 10: Module 4: Living Together, [44] https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/module_4_-_living_together.pdf.